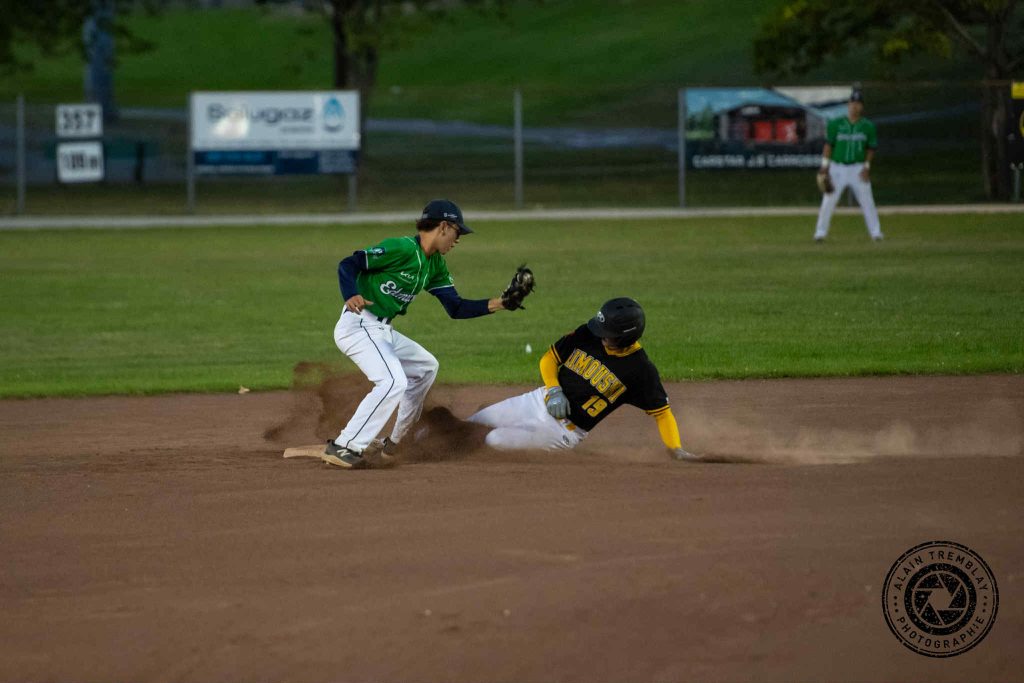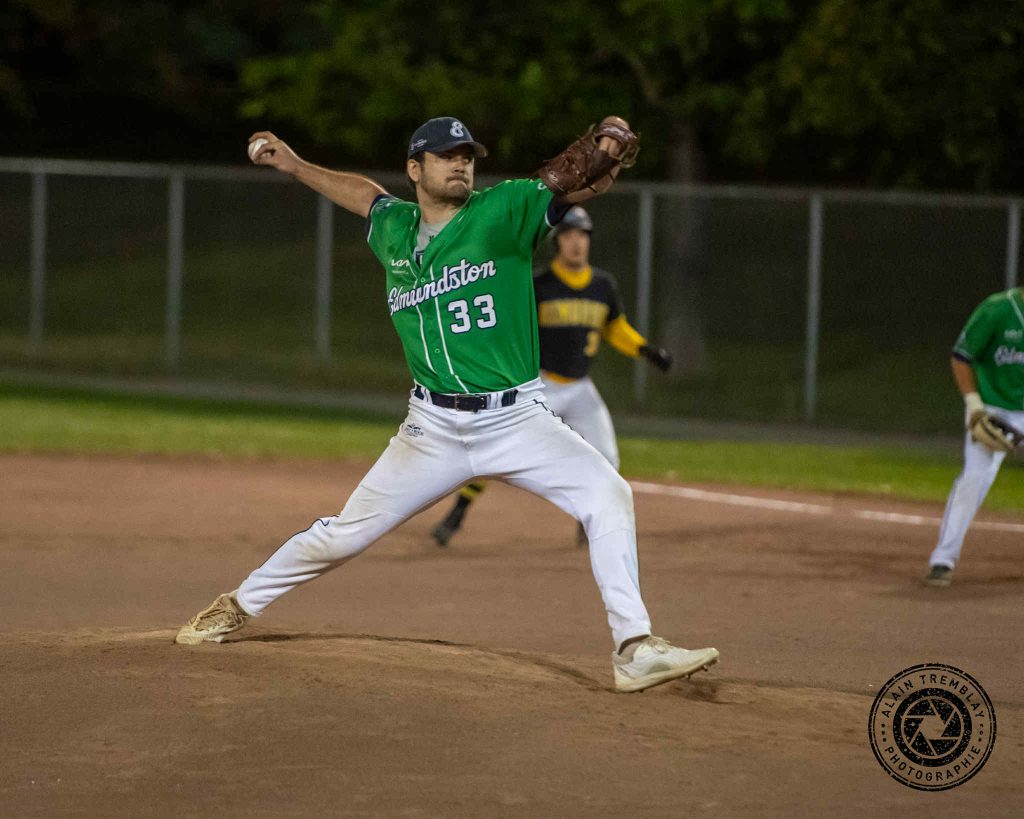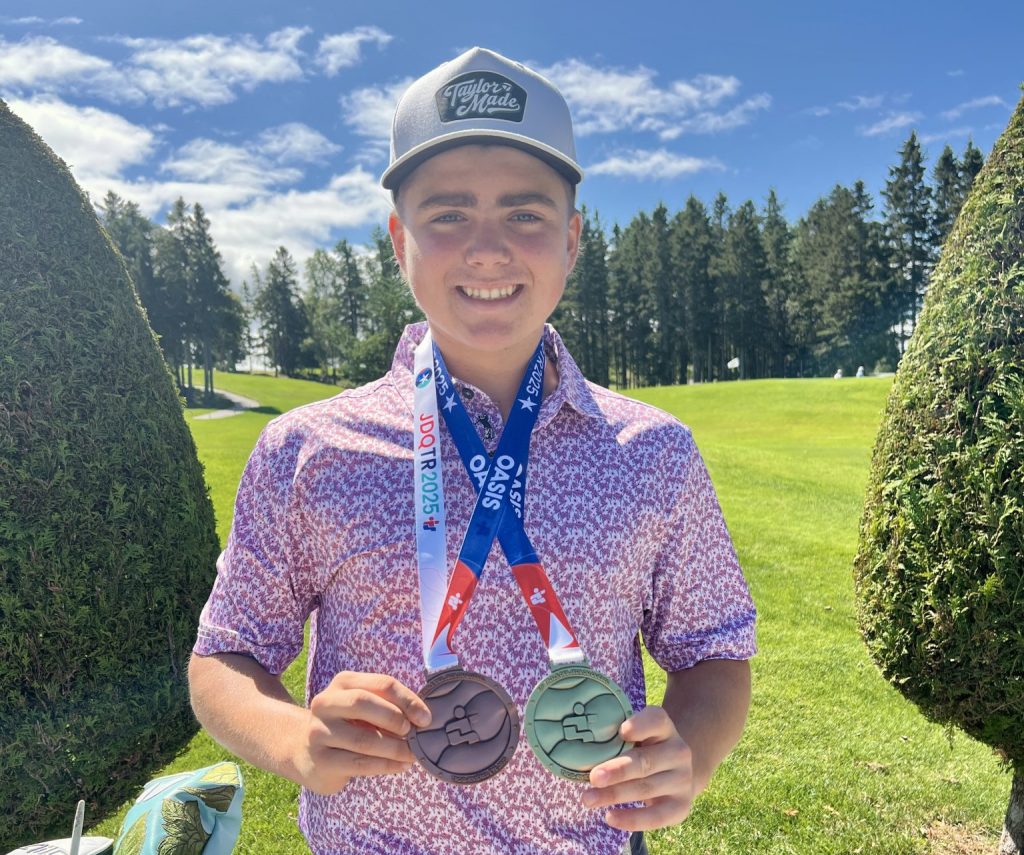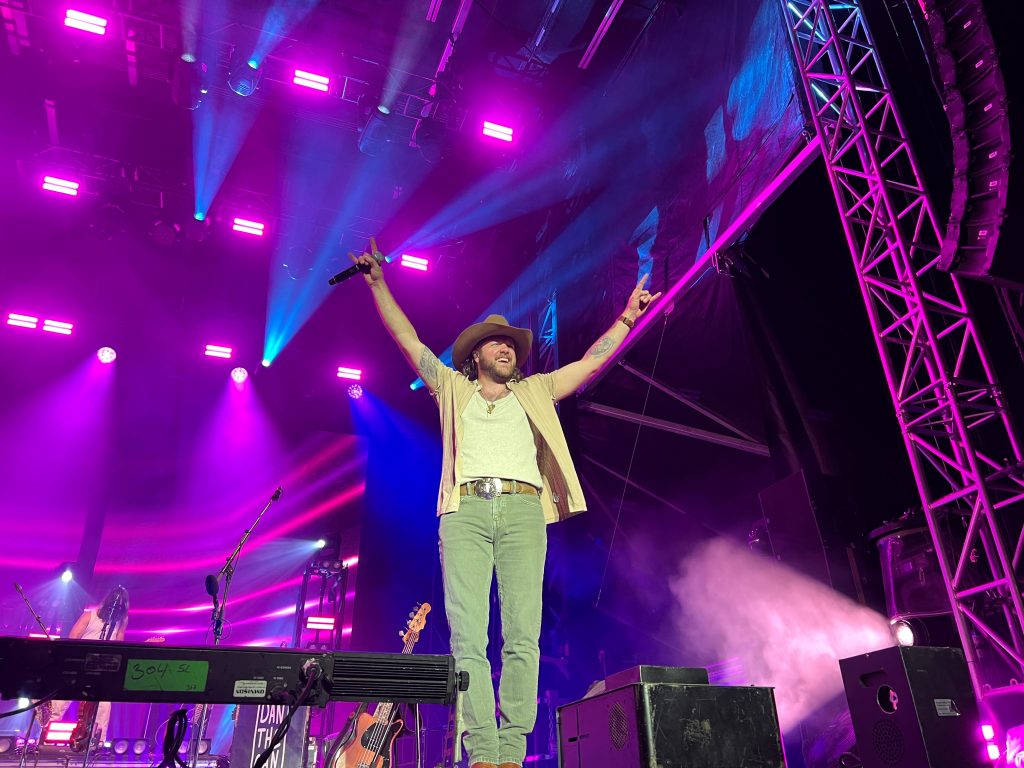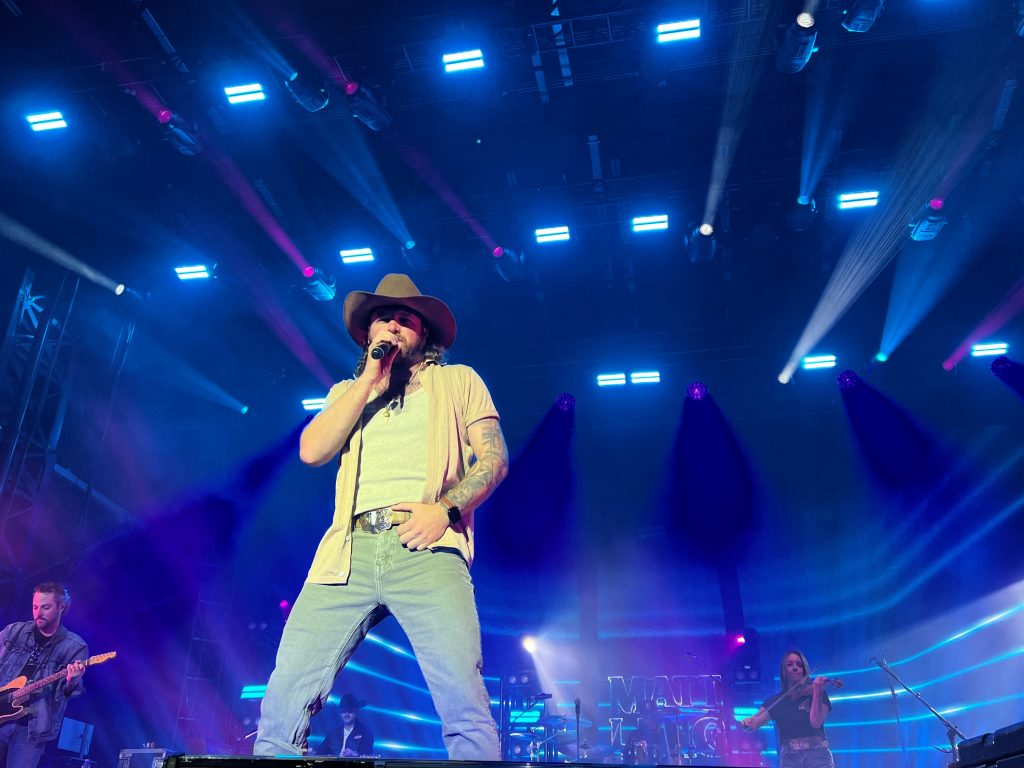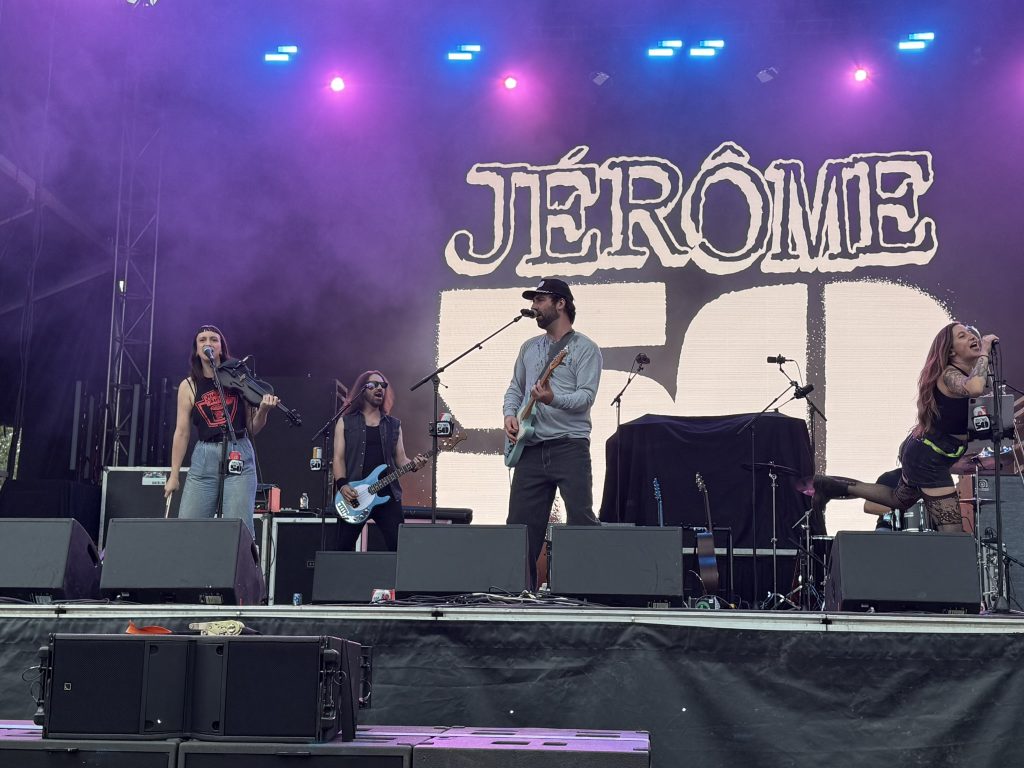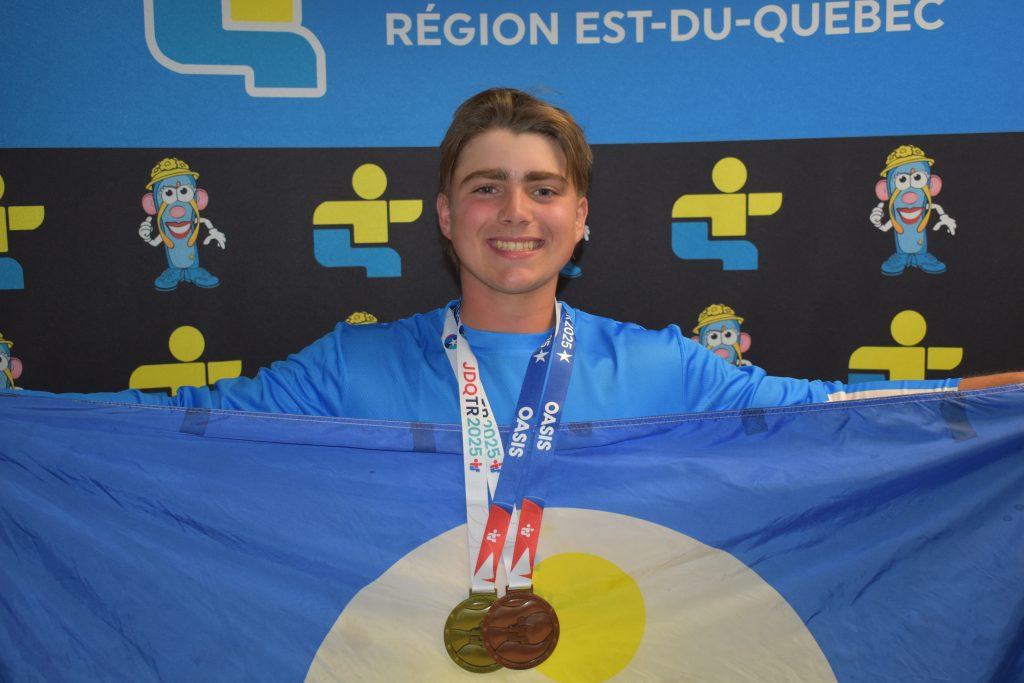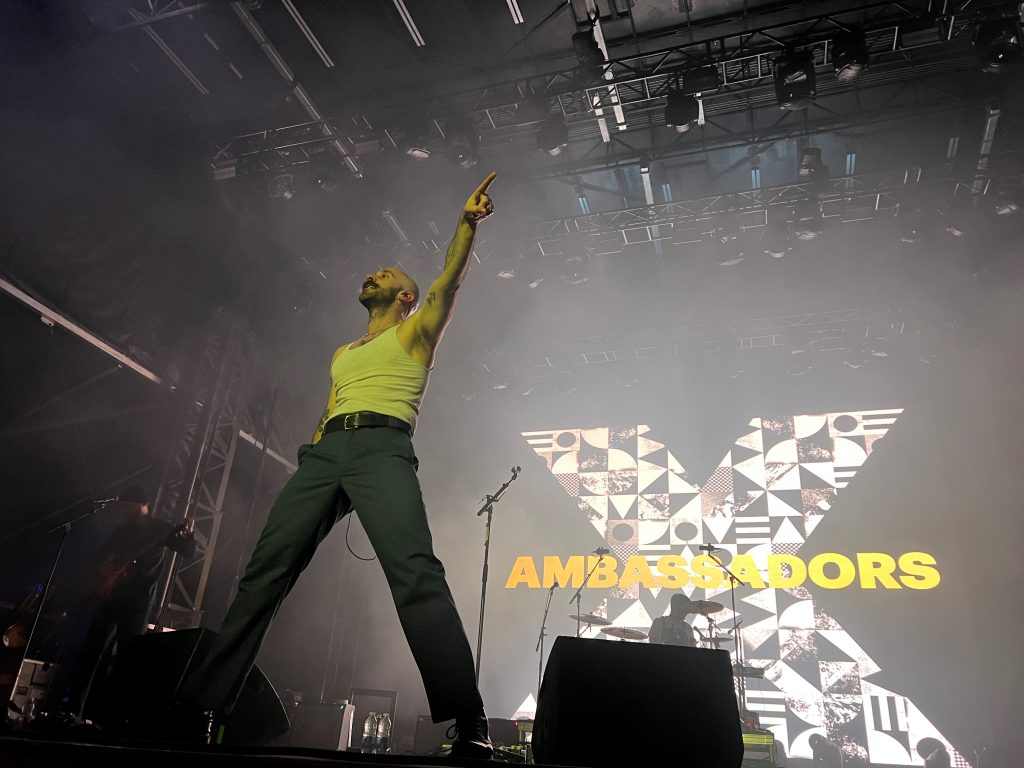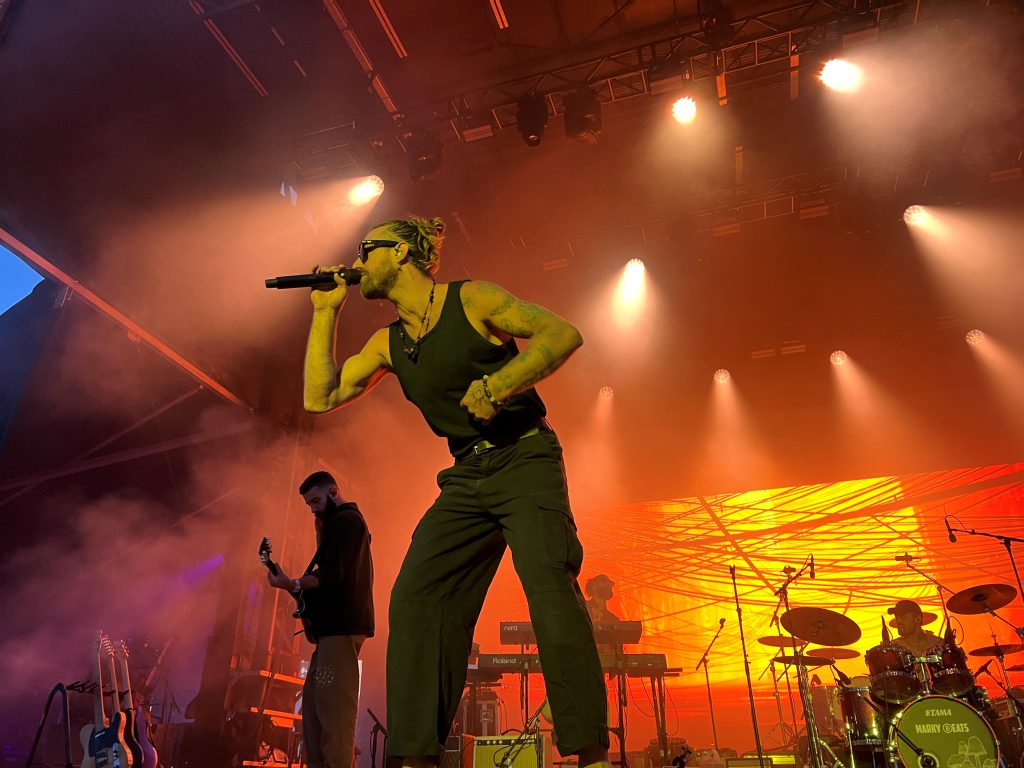En trente ans, le Saint-Laurent a changé. Pas toujours pour le pire, mais rarement pour le mieux sans y être poussé. Le fleuve que l’on disait grand, nourricier, indomptable est devenu fragile à force d’usure. Et pendant que ses eaux poursuivent leur course vers l’Atlantique, les enjeux qui l’assaillent, eux, s’accumulent.
Au milieu des années 1990, le grand souci, c’était la pollution chimique. Des contaminants bien connus — BPC, mercure, plomb — s’invitaient dans les tissus des poissons, des oiseaux, des mammifères marins. On surveillait les bélugas comme des indicateurs vivants d’un écosystème intoxiqué. On espérait que la réglementation finirait par inverser la tendance. Et, en partie, elle l’a fait. Les concentrations ont diminué. Mais pendant qu’on applaudissait ces reculs toxiques, d’autres polluants, plus discrets mais tout aussi persistants, prenaient leur place : microplastiques, perturbateurs endocriniens, résidus pharmaceutiques. Invisibles à l’œil nu, omniprésents au microscope.
Le Saint-Laurent, en 1995, était déjà fatigué. Mais il n’était pas encore essoufflé. C’est le climat qui allait accélérer les choses. Car depuis, les eaux se sont réchauffées. Lentement, mais sûrement. D’un à deux degrés Celsius selon les zones, ce qui suffit à bousculer tout un réseau trophique. Le krill comme la crevette nordique se font rares dans l’estuaire. Le homard migre. Le saumon décline. Et pendant que la faune cherche refuge, le niveau de la mer monte, les berges s’érodent, les glaces hivernales se font capricieuses. Les municipalités, elles, cherchent encore la bonne combinaison entre enrochements et prières.
Au fil des ans, j’ai eu le privilège de contribuer, à l’occasion, aux pages du Mouton, pour parler de ce Fleuve auquel nous devons tant. Trente ans après les premiers constats alarmants, l’essentiel demeure : comprendre le Saint-Laurent exige de voir au-delà de la surface, d’embrasser toute sa complexité vivante.
Car la biodiversité du Fleuve n’est plus la même qu’il y a trente ans. L’effondrement de la morue dans les années 1990 a laissé un vide que la crevette nordique avait comblé un temps, jusqu’à ce qu’à son tour elle décline sous la pression du réchauffement et de la surpêche. Aujourd’hui, c’est le sébaste — ce survivant d’une autre époque — qui revient occuper l’espace. Chaque espèce qui recule ou réapparaît raconte, à sa façon, une histoire d’adaptation forcée, de rupture des équilibres.
Bien sûr, tout n’est pas sombre. Des gains ont été réalisés. La mise en place d’aires marines protégées a permis de stabiliser certains habitats sensibles. Des efforts de restauration, notamment dans les zones humides et les herbiers, ont porté fruit. L’idée même de coexistence entre usages humains et écosystèmes n’est plus marginale. Elle s’impose. Lentement, mais elle s’impose.
La science a aussi changé. Elle est plus accessible, plus interdisciplinaire, plus enracinée dans les territoires. Les savoirs autochtones commencent enfin à être pris au sérieux — pas comme anecdotes folkloriques, mais comme corpus de connaissances complémentaires. Et les jeunes scientifiques, aujourd’hui, arrivent armés de drones, de capteurs et d’une conscience écologique qui dépasse les silos.
Malgré cela, le Saint-Laurent reste une promesse incertaine. Un système immense, complexe, vulnérable. Sa biodiversité n’est pas stable. Ses écosystèmes ne sont pas résilients par magie. Et sa santé ne se mesure pas à coups de photos Instagram de baleines à bosse.
Depuis plusieurs années, je parle beaucoup de « léguer un fleuve en santé » quand on me demande mon avis sur le Fleuve. C’est noble, bien sûr. Mais cela suppose qu’on en hérite, qu’on en prend soin, et qu’on le transmet. Or, on agit encore trop souvent comme s’il s’agissait d’un bien jetable, renouvelable à volonté. L’exploitation industrielle, la navigation, l’urbanisation : tout s’accumule. Et le Fleuve, lui, absorbe. Jusqu’à quel point?
Trente ans après, les grandes menaces ne sont plus seulement chimiques ou visibles. Elles sont systémiques. Le Saint-Laurent ne meurt pas d’un coup. Il s’érode, se transforme, se dérègle. Et l’enjeu n’est plus seulement de le « sauver », mais de réapprendre à vivre avec lui. En fonction de lui. Pas contre.
Il reste des raisons d’espérer. Elles ne tiennent pas à des miracles technologiques, mais à la volonté collective. Des communautés riveraines qui refusent le statu quo. Des pêcheurs qui adaptent leurs engins. Des scientifiques qui traduisent leur savoir. Des enfants qui ramassent des déchets sans que personne ne les y oblige.
C’est peut-être là, le vrai basculement des trente dernières années : dans la lente, mais réelle montée d’une écologie de responsabilité. Pas parfaite. Pas suffisante. Mais tenace.
Et si l’on doit, un jour, dresser le bilan de notre passage collectif, peut-être que la seule vraie question sera celle-ci : avons-nous été dignes du Fleuve?