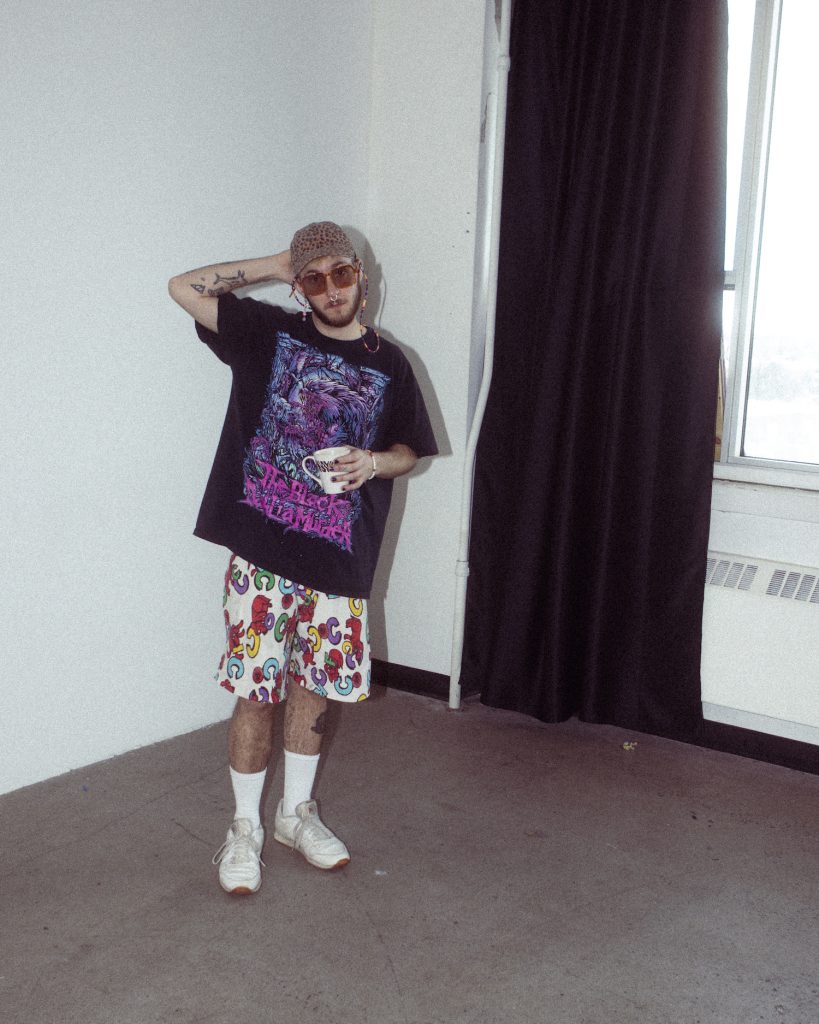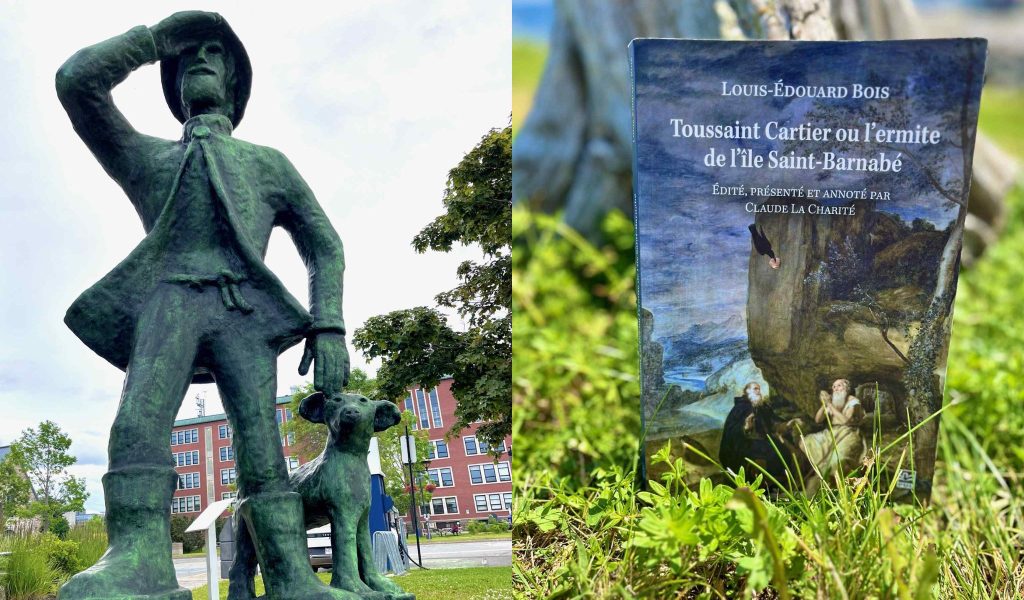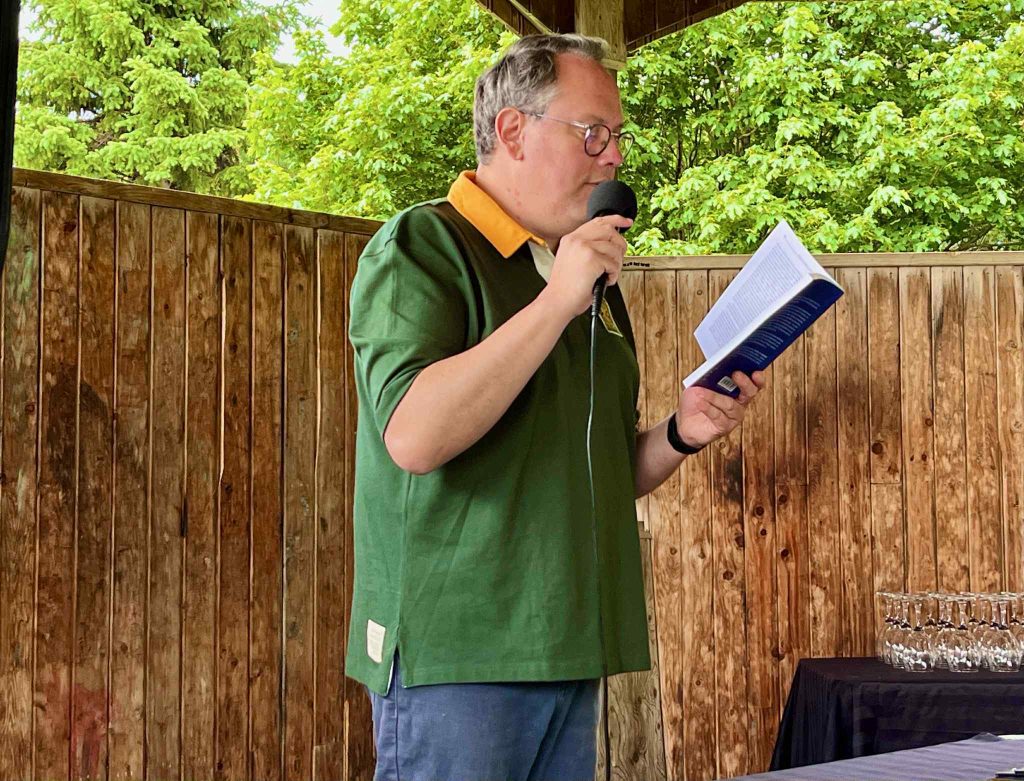Volte-face de Québec : est-il trop tard?

Il aura fallu une levée de boucliers générale pour que le gouvernement Legault entende finalement raison. Devant la grogne généralisée, Québec a annoncé, la semaine dernière, qu’il injectera 540 M$ supplémentaires dans le réseau scolaire pour préserver les services aux élèves. Une volte-face qui soulève une question fondamentale: est-il trop tard?
L’opinion de Johanne Fournier
J’ai posé la question à une maman du Bic, dont les services sur lesquels pouvait compter son fils seront supprimés à la rentrée. La classe de Jeffrey-Lou, dont le personnel était spécialisé dans le trouble du spectre de l’autisme, n’existera plus. « Le ministre a annoncé qu’il ajouterait des millions pour les services aux élèves, convient Marie-Josée Aubin. Mais, le mal est déjà fait: les postes sont déjà supprimés. »
Vent de panique
Rappelons les faits. En mars, le budget 2025-2026 a annoncé des compressions en éducation. En juin, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a passé une commande aux centres de services scolaires: réduire leurs dépenses de 570 M$.
Le résultat? Un vent de panique a soufflé sur les écoles. Des directions ont imploré Québec de reculer sur ces coupes dévastatrices, sans quoi des services essentiels aux élèves seraient annulés à la rentrée. Les centres de services scolaires ont dû préparer des listes de suppressions qui donnent le vertige: postes d’enseignants, services d’orthopédagogie, aide aux élèves en difficulté, transport scolaire.
Une injection salutaire, mais…
Le recul du gouvernement constitue certes un pas dans la bonne direction. Mais, cette somme de 540 M$ est-elle suffisante?
La réponse des syndicats est non, car cette injection de dernière minute ne réparera pas les dégâts collatéraux causés par les coupes draconiennes planifiées pendant des mois par les directions d’école: du personnel licencié, des services annulés, des projets éducatifs mis en veilleuse. Peut-on remettre la machine en marche comme si de rien n’était? Personne ne semble y croire.
Problème de gouvernance?
Cette crise révèlerait-elle un problème de gouvernance plus profond? Comment un gouvernement qui clame faire de l’éducation sa priorité peut-il en arriver à menacer les services aux élèves?

Plus inquiétant encore: comment, avec cette volte-face, arrivera-t-on à résoudre l’équation budgétaire de fond? Si Québec injecte 540 M$, d’où viendra cet argent? Dans un contexte où le Québec nage en plein déficit, cette rallonge budgétaire ne risque-t-elle pas de créer des tensions ailleurs ou de pelleter le problème dans la cour de quelqu’un d’autre?
Pour les acteurs du milieu scolaire, cette façon d’aller de l’avant du gouvernement pour ensuite rétropédaler est épuisante. Ils ont besoin de prévisibilité, de planification à long terme. En éducation comme ailleurs, gouverner, c’est prévoir. Or, à ce chapitre, le ministre de l’Éducation aurait-il une leçon à apprendre?