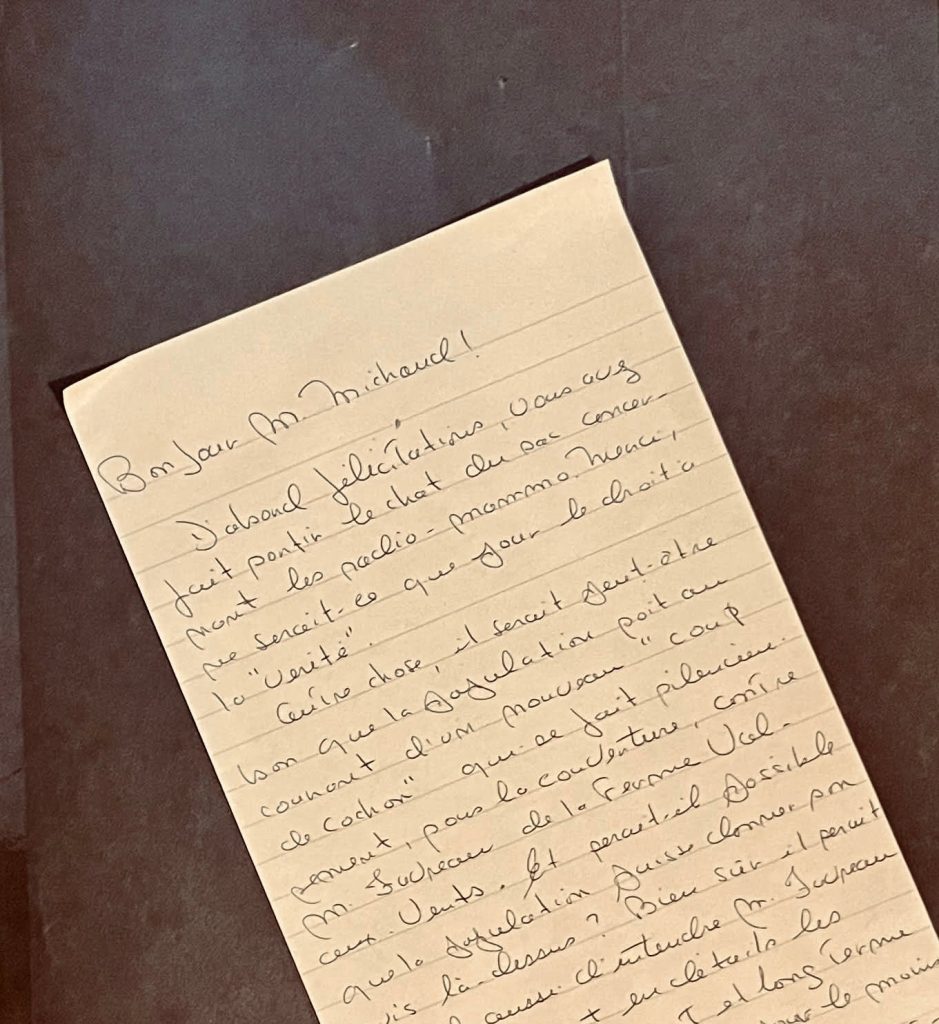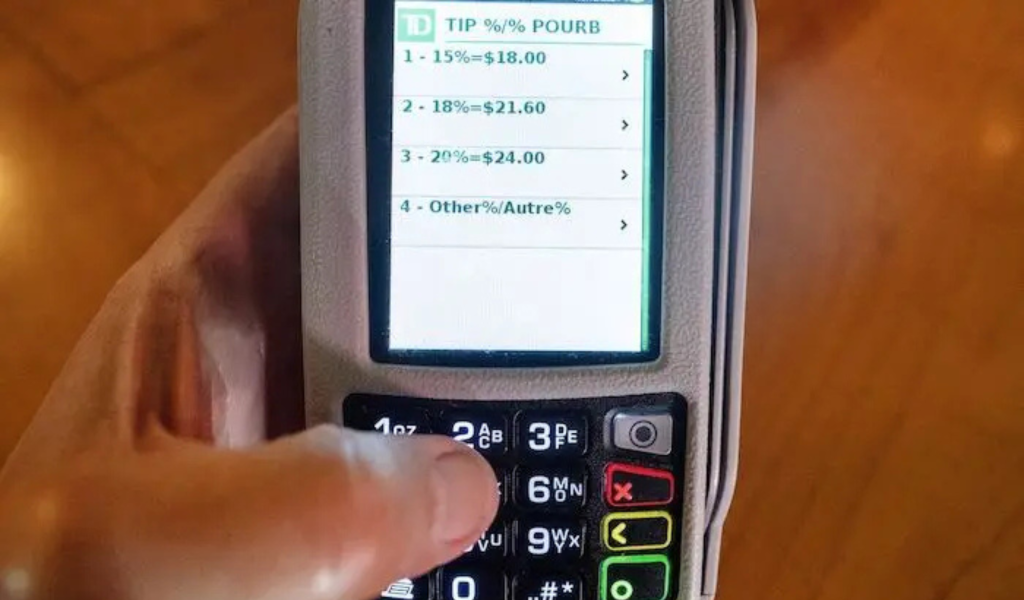Les lieux d’ici : l’histoire de chaque nom

Certains noms de lieux nous intriguent, nous touchent ou nous font sourire. Dans cette série, on s’attarde à quelques lieux de chez nous, choisis pour leur histoire singulière, leur nom évocateur ou simplement parce qu’ils nous parlent.
Un clin d’oeil à nos racines et à ceux qui ont donné une identité à notre territoire, un nom à notre coin de pays.
Rimouski-Neigette
Esprit-Saint

Dans le canton de La Roche, à 50 km au sud de Rimouski, ce petit village du Bas-Saint-Laurent est situé près de La Trinité-des-Monts. Cette proximité justifie sans doute l’appellation choisie, également appliquée au bureau de poste en 1939. Esprit-Saint a d’abord été un territoire non organisé en 1972 avant d’être érigé en municipalité en 1979.
Auparavant, la paroisse de L’Esprit-Saint, d’abord instituée comme desserte en 1937 puis érigée canoniquement en 1964, regroupait la communauté locale. Le nom d’Esprit-Saint aurait été donné en raison de l’esprit de courage des colons ou en référence directe à la foi.
Au milieu des années 1970, le territoire a été menacé de fermeture et a survécu grâce à la persévérance et à la ténacité de la population locale qui a lutté dignement pour vivre d’une terre avare de ses fruits.
C’est à la faveur de l’aménagement intégré de ses ressources de base, à savoir l’agriculture, l’exploitation forestière et le tourisme qu’il a pu être sauvé in extremis dans la foulée des Opérations-Dignités qui ont marqué le Bas-Saint-Laurent, il y a près de vingt ans.
Aujourd’hui, l’existence de la réserve Duchénier (1977), au nord-ouest d’Esprit-Saint, assure pour une bonne part la prospérité des villageois grâce à ses 150 km2 d’espaces consacrés à la pêche et à la chasse.
Une fabrique de bardeaux de cèdre, qui constituait la principale industrie de l’endroit, a été la proie des flammes en mai 1991. Cette tragédie a affecté une économie déjà mal en point.
Gentilé : Spiritois, Spiritoise
Saint-Eugène-de-Ladrière

La municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a été implantée à 25 kilomètres au sud-ouest de Rimouski, à la limite est de la MRC de Rimouski-Neigette, au sud de Saint-Fabien. La Petite rivière Rimouski, la rivière du Bic, le lac des Vingt-Quatre Arpents ainsi que de nombreux autres plans d’eau contribuent à marquer la topographie de cet espace municipal.
D’existence récente, quoique le territoire ait été habité dès 1860, tant la paroisse que la municipalité de la paroisse de Saint-Eugène-de-Ladrière remontent sur le plan administratif à 1962. Toutefois, dès 1930, on parlait de la desserte de Saint-Eugène-de-Ladrière.
Le territoire municipal est issu d’une partie de celui de la municipalité de la paroisse de Saint-Fabien. C’est en l’honneur de l’abbé Eugène-Elzéar Pelletier, curé de Saint-Fabien de 1912 à 1937 que l’élément Saint-Eugène a été retenu. Ce prêtre a fortement encouragé des paroissiens à se montrer généreux lors du détachement de Saint-Eugène-de-Ladrière de Saint-Fabien.
Quant à Ladrière, nom du bureau de poste également, ouvert en 1919, il rappelle le souvenir de l’abbé Augustin Ladrière (1826-1884), notamment curé de Saint-Fabien-de-Panet (1855-1870) et de L’Isle-Verte (1870-1875), avec desserte de Saint-Paul-de-la-Croix. Les principales ressources locales proviennent de la culture de la terre, de l’élevage du bœuf de boucherie et de l’exploitation de tourbières. Les sports de plein air occupent une place de choix parmi les activités de loisir pratiquées localement.
Gentilé : Eugénois, Eugénoise
Mont-Lebel

Le nom Mont-Lebel identifie un secteur de la nouvelle ville de Rimouski, créée le 1er janvier 2002. Le territoire de ce secteur correspond à celui de l’ancienne municipalité de Mont-Lebel. Au moment de son annexion avec la Ville de Rimouski, elle compte 334 habitants.
Petite localité forestière créée en 1932 dans l’arrière-pays de Rimouski, dont elle est distante d’environ une vingtaine de kilomètres, entre Sainte-Blandine au nord, dont elle a été détachée, et Saint-Narcisse-de-Rimouski au sud. L’endroit doit son nom à son premier maire, Jean-Baptiste Lebel, qui a présidé aux destinées de la municipalité de 1932 à 1934.
Par ailleurs, d’autres municipalités du Québec comportent également l’anthroponyme Lebel dans leur dénomination : Lebel-sur-Quévillon dans le Nord-du-Québec et Pointe-Lebel sur la Côte-Nord, patronyme par ailleurs répandu dans le Bas-Saint-Laurent.
Composé à l’origine de 41 lots situés dans le Troisième Rang des cantons de Macpès et de Neigette et de 33 lots dans le Quatrième Rang des mêmes cantons, le territoire de l’actuelle municipalité était autrefois désigné sous la dénomination de Rang-Double. L’économie locale repose essentiellement sur l’agriculture.
Selon la Société rimouskoise du patrimoine, un premier groupe de six familles s’installe à Sainte-Blandine en 1854, alors appelée la « Montagne. » En 1932, une partie de la municipalité se détache et devient Mont-Lebel. Le pont des Draveurs du Mont-Lebel, reconnu depuis 2000 comme un « bien patrimonial représentatif de la municipalité » a été construit en 1930. Il est situé sur la route du Lac-à-Quenon et enjambe la petite rivière Neigette.
Gentilé : Lebelmontois, Lebelmontoise
Saint-Marcellin

Implantée au sud de Pointe-au-Père et de Saint-Anaclet-de-Lessard, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rimouski, Saint-Marcellin compte un grand nombre de lacs (Noir, Carré, Lunettes, à la Poire et Ednard).
Combinée à l’importance de la forêt locale, cette richesse hydrographique, à laquelle il faut ajouter les rivières Neigette et Lunettes, explique l’attrait qu’exerce le territoire marcellinois auprès des pêcheurs et des chasseurs. Ouvert en 1875, l’endroit est considéré comme mission à compter de 1899, laquelle relève territorialement des cantons de Neigette, de Macpès et de Ouimet. La future paroisse est placée sous le vocable de Saint-Marcellin dès 1882.
Voisine de Saint-Anaclet-de-Lessard, le choix de son appellation serait dû au fait qu’Anaclet, ou Clet, et Marcellin sont inscrits le même jour au martyrologe, soit le 26 avril.
Confirmée lors de l’érection canonique de 1921, la dénomination, qui identifiait déjà le bureau de poste depuis 1909, sera transférée à la municipalité créée officiellement en 1924. Elle évoque un pape d’origine romaine qui succède à saint Caïus sur le trône pontifical. Son règne s’est échelonné de 296 à 304.
Gentilé : Marcellinois, Marcellinoise
Le Bic

La municipalité du Bic n’existe plus depuis le 16 septembre 2009. Elle a été annexée à Rimouski. L’appellation Le Bic a toutefois été préservée et elle identifie maintenant un secteur correspondant au territoire de l’ancienne municipalité.
Le gouvernement a établi un parc de conservation d’une superficie de 33 km², le parc de conservation du Bic. La profondeur du havre du Bic en fait un abri sûr et l’un des mouillages importants du Saint-Laurent où le général Wolfe et sa flotte ont fait une halte en 1759.
L’histoire bicoise remonte aux débuts de la colonie et même plus loin dans le temps, car en 1535, Jacques Cartier s’est arrêté au havre du Bic, tout comme Champlain le fera en 1603. Ce dernier est d’ailleurs l’auteur de la dénomination, car il appelle l’endroit le Pic, puis mentionne « dudict pic », à propos d’une montagne assez élevée (347 m) et pointue qui domine le havre.
Par corruption lexicale, Pic serait devenu Bic, d’où le nom Bic repris lors de la création de la seigneurie en 1675 et du bureau de poste en 1832. Ce sommet porte aujourd’hui le nom officiel Pic Champlain.
Sur le plan municipal, Le Bic provient de la fusion, en 1972, des municipalités de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic et du village de Bic, respectivement créées en 1845 et en 1920. La dénomination Sainte-Cécile-du-Bic provient de celle de la paroisse érigée canoniquement en 1830 et desservie comme mission entre 1793 et 1850.
Gentilé : Bicois, Bicoise
Pointe-au-Père

La ville de Pointe-au-Père n’existe plus depuis le 1er janvier 2002, par suite d’un regroupement municipal.
Son territoire fait maintenant partie de la ville de Rimouski et le nom « Pointe-au-Père » a été préservé pour identifier le secteur. Pointe-au-Père, suivant le nom adopté officiellement en 1988, constitue un territoire de plaine échelonnée sur des terrasses se prolongeant en une pointe découpée d’anses qui s’avance dans le fleuve, un peu en aval de Rimouski. À l’exemple d’autres endroits consacrés à sainte Anne, Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père devenait un lieu de pèlerinage à compter de 1873.
Cette appellation allait également servir à identifier une paroisse érigée canoniquement en 1882, par suite de son détachement de Saint-Germain-de-Rimouski et de Sainte-Luce et une municipalité de paroisse établie la même année.
Le nom choisi, attesté en 1696 dans l’acte de concession de la seigneurie Lessard, en plus de marquer la dévotion des marins à l’endroit de sainte Anne qui assure leur protection, rappelle un événement historique, soit la célébration de la première messe sur la rive sud du Saint-Laurent, le 8 décembre 1663. Les lieux ont également porté les appellations de Pointe-aux-Pères, Father Point (carte de Carver, 1763), Pointe-de-l’Islet-aux-Pères et Pointe-de-l’Isle-aux-Pères.
La première évoque le fait que de nombreux missionnaires s’arrêtaient à cet endroit et la seconde constitue la transposition anglaise de Pointe-au-Père, figurant sur des cartes et identifiant le bureau de poste créé en 1863, jusqu’au début des années 1970 alors qu’il a pris le nom de Pointe-au-Père. La dernière souligne la possibilité qu’à une certaine époque la bande de terre située entre les deux anses qui découpent la pointe au Père en se rejoignant presque ait présenté l’allure d’une petite île,
un islet.
Gentilé (à l’époque où Pointe-au-Père était une ville) : Pèrepointois, Pèrepointoise.
Saint-Anaclet-de-Lessard

Saint-Anaclet-de-Lessard est une municipalité qui appartient aujourd’hui à la banlieue de Rimouski. Érigée en 1859, elle doit son nom à la paroisse établie en 1858, laquelle comptait déjà 1 100 habitants en 1861, ainsi qu’un bureau de poste ouvert en 1859 sous l’appellation de Saint-Anaclet. Le pape Anaclet (ou Clet), martyr du Ier siècle, a régné de 76 à 88.
Selon le site internet de la municipalité, le 8 mars 1696, le gouverneur Frontenac concède la seigneurie de Lessard à Pierre de Lessard et à barbe Fortin. Le seigneur n’habitera jamais sa propriété. Des gens de Québec et de l’île d’Orléans développeront ces lieux à compter de 1810.
Ils recevront le surnom de Castors en raison de la présence significative de ces animaux le long des cours d’eau. L’église de la municipalité présente notamment un intérêt patrimonial pour sa valeur historique comme témoin de l’établissement de la communauté de Saint-Anaclet-de-Lessard et de son évolution. Les premiers habitants qui s’y installent sont disséminés sur le territoire.
En raison de leur éloignement des centres de peuplement voisins, soit Sainte-Luce et Saint-Germain, ils réclament la création d’une paroisse distincte. Dès 1854, quelques familles signent une convention s’engageant à construire à leurs frais une église et un presbytère. Les autorités religieuses établissent une mission en 1857 et promulguent l’érection canonique de la paroisse en 1858, sous le vocable de Saint-Anaclet.
L’église actuelle est mise en chantier, tout comme le presbytère qui est aménagé à partir d’une maison existante. Ces édifices religieux sont épargnés par l’incendie de 1945 qui détruit une partie du village.
Gentilé : Anaclois et Anacloise
La Trinité-des-Monts

La municipalité de la Trinité-des-Monts se trouve aujourd’hui dans la section Centre-Sud de la MRC de Rimouski-Neigette, au nord-est d’Esprit-Saint, immédiatement au sud-ouest de Saint-Narcisse-de-Rimouski, sous l’angle territorial.
Arrosé par les eaux des rivières du Cenellier, Rimouski et Brisson, le territoire compte la majorité de sa population dans son secteur ouest et son ouverture remonte au début des années 1960 avec l’érection canonique de la paroisse de Trinité-des-Monts en 1963, suivie, deux ans plus tard, de son érection civile tout comme de l’établissement de la municipalité de paroisse qui en a repris la désignation.
Sur le plan municipal, Esprit-Saint (1972) et La Trinité-des-Monts (1965) ont été détachées d’un vaste territoire de l’arrière-pays, pratiquement vide et dont ne subsiste que le territoire non organisé de Lac-Huron. Selon le site internet de la municipalité, la Trinité-des-Monts est née par un été de 1937.
La mission de l’Esprit-Saint était le nom des deux futures paroisses soit Trinité-des-Monts et Esprit-Saint, scindée en deux entités distinctes dès 1941. Le nom de La Trinité-des-Monts arriva en 1941 en même temps que Monseigneur Parent qui visitait la paroisse. Cherchant un site pour construire l’église, il voit en regardant vers l’est, les monts Notre-Dame. Érigée en municipalité en 1965, elle est depuis ce temps la municipalité ayant la plus grande superficie du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette.
Pour sa part, le bureau de poste de l’endroit a tour à tour porté les noms d’Esprit-Saint (1938-1939), de Cenellier (1939-1943) et de La Trinité-des-Monts (depuis 1943). L’une des plus jeunes municipalités de l’arrière-pays, La Trinité-des-Monts compte un centre de plein air assez fréquenté.
Gentilé : Trinitois, Trinitoise
La Mitis
La Rédemption

En janvier 1956 se créait, dans la région du Bas-Saint-Laurent, au sud-est de Mont-Joli, entre Saint-Cléophas et Saint-Charles-Garnier, la municipalité de la paroisse de La Rédemption. Son nom, qui reprend celui du bureau de poste établi en 1935 et de la paroisse érigée canoniquement et civilement en 1948, évoque le rachat du genre humain par Jésus-Christ suivant la religion chrétienne, événement capital qui inaugure le Nouveau Testament.
Cette appellation est à rapprocher d’autres de même nature comme L’Ascension, La Conception, L’Assomption, attribuées à des paroisses et à des municipalités québécoises. Elle témoigne du sentiment religieux qui animait les Québécois de l’époque, particulièrement dans les milieux ruraux. Le lieu est surtout connu par la présence, dans le Troisième Rang, de phénomènes karstiques (phénomène géologique créé sur la surface terrestre par le drainage de l’eau dans le sol) dans le sentier spéléologique de La Rédemption.
On y rencontre de nombreuses grottes, pertes ou autres types de formations. On peut y visiter une grotte d’une profondeur de près de 47 m et de 300 m de développement, dénommée Spéos de la Fée, qui attire de nombreux spéléologues, conquis par le trou du Lièvre, la Diaclase, le trou du Porc-Épic, la grotte Saint-Laurent… Il s’agit de la plus profonde cavité naturelle connue tant sur le plan régional que provincial.
Gentilé : Rédemptois, Rédemptoise
Les Boules (Métis-sur-Mer)

Le secteur des Boules, qui, depuis 2002, est inclus dans la ville de Métis-sur-Mer, se situe à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Matane. Le territoire de ce secteur correspond à celui de l’ancienne municipalité des Boules, fondée en 1952.
Cette dénomination, attribuée d’abord au bureau de poste ouvert en 1911, est tributaire de la présence, à tout le moins anciennement, de plusieurs rochers de forme arrondie et de bonne taille sur le bord du fleuve. Il s’agit de blocs erratiques, c’est-à-dire de grosses roches abandonnées par les glaciers, polies par les vagues et souvent déplacées par le mouvement des glaces. Le nom Les Boules et la forme La Boule seraient en usage depuis au moins le début du XIXe siècle.
La forme au singulier a d’ailleurs été relevée sur la carte de 1831 de Joseph Bouchette. Le nom de ce secteur suscite certains problèmes lorsqu’on doit l’intégrer dans une phrase, plusieurs soutenant à tort qu’il faut écrire « je vais à Les Boules » pour respecter intégralement l’appellation municipale, alors que la syntaxe correcte requiert plutôt d’écrire « je vais aux Boules. »
Gentilé : Boulois, Bouloises
Padoue

Padoue est le nom d’une ville de la région de la Vénétie, dans le nord de l’Italie. S’il a été attribué à une municipalité de La Mitis, au Bas-Saint-Laurent, c’est davantage pour rendre hommage à saint Antoine de Padoue. Ce dernier s’est illustré par sa prédication surtout en Italie et en France.
De nombreuses légendes concernant sa vie ont pris naissance à sa mort et on l’invoque encore spécialement pour retrouver les objets perdus. On a d’abord donné son nom à la paroisse érigée en 1911, puis à la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue-de-Kempt, établie en 1912.
L’élément Kempt rappelle que le chemin Kempt, qui se rendait jusqu’à Causapscal en longeant la rivière Matapédia, a joué un rôle de premier plan dans la colonisation du territoire matapédien; il permet la distinction avec d’autres Saint-Antoine dans Gaspé et dans Bonaventure.
Ce nom de lieu rendait hommage à sir James Kempt, qui avait notamment été gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, entre 1828 et 1830. Avant de recevoir le nom actuel Padoue en 1914, le bureau de poste local, ouvert en 1903, était incidemment dénommé Kempt Station.
L’ampleur spatiale que couvre cette dénomination municipale allait inciter les autorités locales à modifier l’appellation originelle dans le sens de la brièveté en 1981, ne retenant que le constituant le plus significatif, qui identifiait le bureau de poste depuis longtemps, également par souci de pallier toute confusion.
Gentilé : Padovien, Padovienne
La Matapédia
Val-Brillant

Avant 1883, on parle de Lac-Matapédia, nom repris par le bureau de poste entre 1894 et 1904, en raison de la proximité de ce plan d’eau, alors que débutent l’exploration de la région et la construction du chemin Kempt. Lui succédera, Brochu ou Brouché, ainsi déformé par les anglophones, ou encore Lac-à-Brochu en l’honneur du premier colon de la Vallée, Pierre Brochu (1795-1871), qui s’installe à la tête du lac Matapédia.
Cette appellation subsistera jusqu’en 1871, alors que McGowe s’imposera, tirée du patronyme de l’ingénieur qui entreprend les travaux de la section n° 14 de l’Intercolonial. De 1876 à 1883, Cedar Hall deviendra courant, d’après le hangar en pièces de cèdre qui sert de remise pour les outils à charbon utilisés lors des travaux ferroviaires. À cet égard, soulignons que le bureau de poste a porté cette appellation d’abord entre 1881 et 1894, puis de 1904 à 1912, avant de recevoir sa dénomination actuelle Val-Brillant en 1912.
La création de la mission de Saint-Pierre-du-Lac en 1883 reléguera aux oubliettes Cedar Hall, sauf dans le domaine des postes. Érigée canoniquement en 1889 et civilement en 1890, la paroisse reprend le prénom de l’abbé Pierre Brillant (1852-1911), missionnaire à cet endroit de 1881 à 1889 et curé de 1889 à sa mort.
Son zèle et son amour pour la vallée de la Matapédia lui ont valu le surnom de père de la Vallée. La municipalité de village créée en 1915 reprend la dénomination paroissiale, rapidement modifiée l’année suivante en Val-Brillant, déjà usitée depuis 1913.La fusion survenue en 1986 entre cette dernière et la municipalité de Saint-Pierre-du-Lac, créée en 1890, fixera les limites actuelles du territoire.
Gentilé : Val-Brillantois, Val-Brillantoise
Causapscal

La nouvelle ville de Causapscal a été créée le 31 décembre 1997. Elle est issue du regroupement de la ville de Causapscal et de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal. La municipalité du village de Causapscal, créée en 1928 par suite de son détachement de la municipalité de la paroisse de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal (1897) à une vingtaine de kilomètres au sud-est d’Amqui et dont le statut a été modifié en celui de ville en 1965, tire sa dénomination de celle du canton de Casupscull dans la vallée de la Matapédia, proclamé en 1864.
La modification graphique, attestée pour la première fois en 1845 et attribuée au bureau de poste ouvert en 1871, à l’époque des débuts du peuplement, pourrait s’expliquer par interversion du u et du a et remplacement de la lettre u par la lettre a par suite d’un phénomène d’écho phonique.
Par ailleurs, les déformations graphiques sont courantes dans les mots amérindiens adaptés en français. Ce nom provient du micmac Goesôpsiag ou Gesapsgel ou encore Gesôpsgigel ayant pour sens fond pierreux et brillant, eau rapide, pointe caillouteuse, ce dernier sens convenant bien au lit de la rivière Causapscal de nature très caillouteuse.
Des auteurs attribuent cependant à Causapscal et à Casupscull des significations différentes. La situation particulière de la ville, au confluent de la Causapscal et de la Matapédia qui se rejoignent pour former une fourche, lui a valu, vers 1830, le nom de : Les Fourches ou Les Fourches-de-Causapscal, par la suite modifié.
Gentilé : Causapscalien, Causapscalienne
Rivière Patapédia

La rivière Patapédia, qui coule dans la MRC de La Matapédia et qui se jette dans la rivière Ristigouche, porte un nom aux racines autochtones profondes qui témoigne de l’histoire millénaire de ce territoire. Ce cours d’eau, qui marque aujourd’hui la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, a été témoin des passages et des établissements des Premières Nations bien avant l’arrivée des colons européens.
L’étymologie du nom Patapédia trouve ses origines dans la langue parlée par les Mi’kmaq, peuple autochtone qui habitait et fréquentait cette région depuis des temps immémoriaux.
Le terme mi’kmaq « patapegiag » signifie « courant violent et impétueux », une description particulièrement évocatrice qui souligne les caractéristiques naturelles de ce cours d’eau. Une autre interprétation, tout aussi révélatrice, traduit le nom comme « rivière aux courants inégaux et capricieux », mettant en évidence la nature changeante et parfois tumultueuse de ses eaux.
Cette double signification révèle la connaissance intime que les Mi’kmaq avaient de la rivière Patapédia. Leur choix toponymique n’était pas arbitraire, mais résultait d’une observation attentive des comportements de ce cours d’eau. Les courants variables et imprévisibles de la rivière ont influencé les techniques de navigation et de pêche des peuples autochtones, qui ont su s’adapter à ces conditions particulières au fil des générations.
Aujourd’hui, la rivière Patapédia demeure réputée pour ses qualités halieutiques, notamment pour la pêche au saumon atlantique, perpétuant ainsi l’importance de ce cours d’eau dans l’économie régionale et la culture locale, tout en honorant la mémoire des premiers habitants qui lui ont donné son nom.