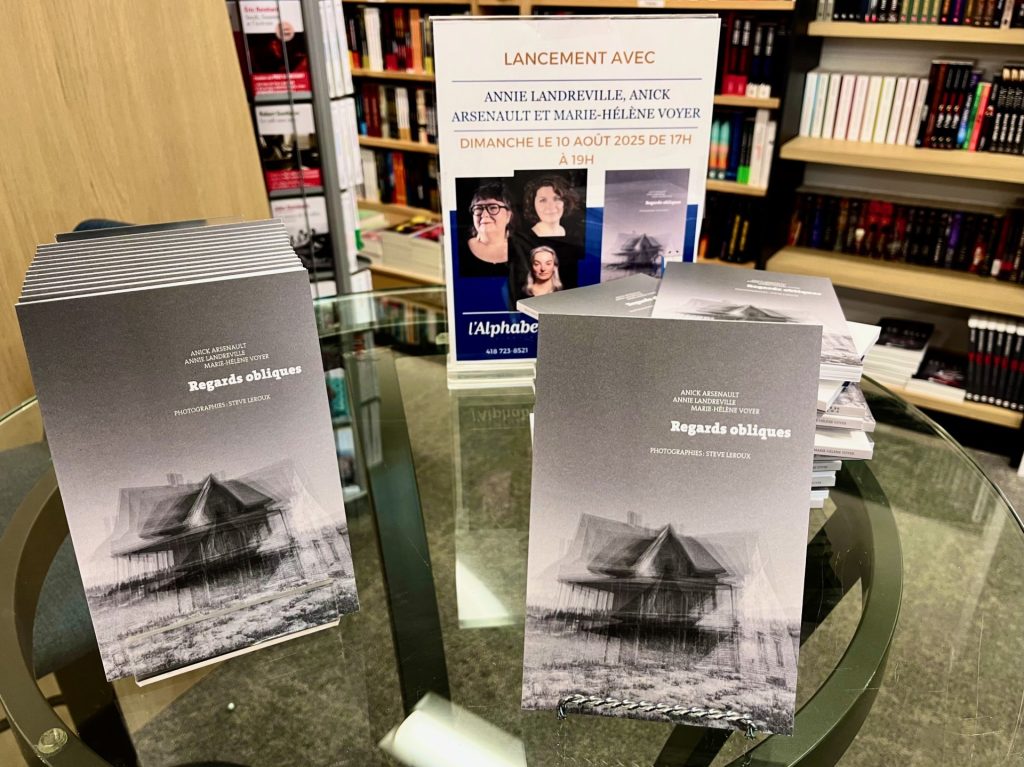Guy Rocher : l’héritage silencieux d’un bâtisseur

Il y a des départs qui laissent un vide immense et d’autres qui révèlent soudain l’ampleur d’une présence qu’on n’avait peut-être pas assez mesurée. La mort de Guy Rocher, survenue le 3 septembre à l’âge vénérable de 101 ans, appartient à cette seconde catégorie.
Son legs dans nos régions
Dans les grandes villes, on salue le géant de la sociologie, l’architecte de la Révolution tranquille, l’homme qui a contribué à façonner le rapport Parent. Ces hommages sont mérités, bien évidemment. Mais, c’est peut-être dans nos régions, loin des projecteurs et des tribunes officielles, que l’œuvre de cet homme prend sa dimension la plus touchante.
Quand Guy Rocher parlait de démocratisation de l’éducation, il ne philosophait pas dans l’abstrait. Il dessinait l’avenir de milliers de jeunes qui, sans ses idées révolutionnaires, auraient peut-être renoncé à leurs rêves, faute d’accès.
Ces cégeps qui ponctuent aujourd’hui notre territoire, de Rimouski à Gaspé, en passant par Matane et Amqui, sont autant de phares allumés par sa vision. Avant lui, combien de nos enfants devaient s’exiler vers les grands centres pour poursuivre leurs études collégiales ? Pire encore, combien y renonçaient tout simplement ?

Son legs se lit dans chaque diplôme remis dans nos établissements régionaux, dans chaque programme délocalisé qui permet à un étudiant de maîtriser les sciences ou les arts sans quitter sa terre natale.
Quand l’Université du Québec à Rimouski accueille ses étudiants, quand le Cégep de Matane ou celui de Gaspé ouvre ses portes chaque automne, c’est un peu l’esprit de Guy Rocher qui anime ces lieux d’apprentissage.
Son message demeure vivant
Mais, au-delà des pierres et des programmes, c’est une philosophie profondément humaine que ce sociologue a semée dans notre société. Dans un Québec qui cherchait encore son identité, il a affirmé que nos accents, nos expressions, nos façons particulières d’être au monde méritaient respect et reconnaissance.
Pour nous, qui portons parfois nos origines comme un fardeau dans un monde qui privilégie l’uniformité urbaine, son message demeure bien vivant.
Guy Rocher n’était pas né dans l’Est-du-Québec. Encore mieux, il était l’homme de tous les territoires du Québec, de toutes ces communautés qu’on disait jadis vouées au sous-développement. Il a cru en nous avant que nous n’osions pleinement croire en nous-mêmes.

Aujourd’hui, quand une étudiante de Rimouski obtient son diplôme universitaire, quand un chercheur de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski publie ses travaux, quand un créateur de Gaspé ou de Percé voit son œuvre reconnue, il y a un peu de Guy Rocher dans cette réussite. Car, il a contribué à bâtir un système qui rend ces parcours possibles, qui transforme les rêves en réalités.
Héritiers de Guy Rocher
Dans le grand concert d’hommages qui accompagne son départ, nos voix régionales peuvent sembler modestes. Pourtant, nous sommes peut-être ceux qui incarnons le mieux sa réussite : une société où l’excellence intellectuelle n’est plus l’apanage d’une élite géographique, où l’on peut naître n’importe où au Québec et prétendre aux plus hautes sphères du savoir.
Guy Rocher s’en est allé, mais son écho résonne encore dans nos écoles, nos universités, nos ambitions collectives. Nous sommes tous un peu ses héritiers et c’est là le plus bel hommage que nous puissions lui rendre.