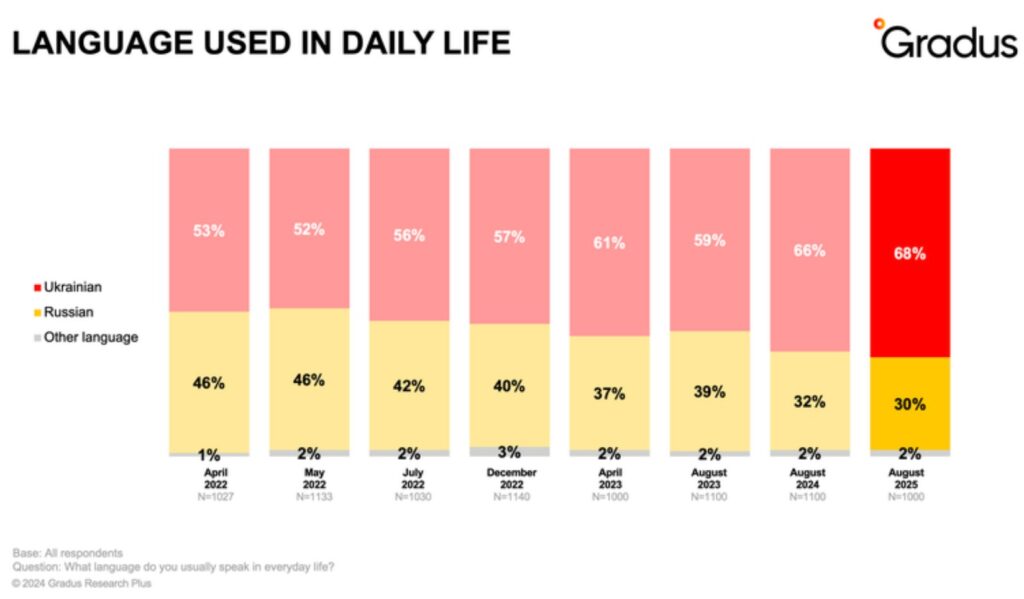“Être autiste”: implicite, connotation et identité [en]
Je réfléchissais à cette question hier soir après avoir lu une partie des échanges qui “font rage” dans un coin de LinkedIn autour de “l’identité autistique“.
Il m’a semblé qu’un élément régulièrement mis de côté par les personnes argumentant « pour » la formulation « être autiste », en faisait des parallèles avec « être barbu » ou « être gaucher » c’est (encore une fois) la question de l’implicite. Au point que je me suis demandé s’il y a quelque chose du côté des caractéristiques de l’autisme à mettre en lien avec ça — la difficulté de tenir compte de l’implicite.
Qu’on le veuille ou non, tout énoncé comporte une part d’implicite. Les mots qu’on utilise ont des connotations. Comme le disait un de mes profs de linguistique, c’est comme des petits wagons qui sont accrochés au mot-locomotive et qui viennent avec quand on l’utilise. Certains mots ont plus de wagons que d’autres.
« Autisme/autiste » et « gaucher » ou « femme » sont tous des mots qu’on peut utiliser pour qualifier une personne. Mais ils n’ont pas les mêmes connotations, pas les mêmes types de « wagons ».
Le problème, à mon avis, avec « autisme comme identité » c’est que c’est une posture qui ne tient pas compte de ces wagons et par conséquent du décalage très grand entre l’intention de sens pour la personne qui dit « je suis autiste » et les associations qu’évoque ce terme chez l’écrasante majorité des personnes qui vont lire/entendre cette phrase.
On n’est pas libre d’utiliser les mots de la façon qu’on veut sans tenir compte de la signification perçue par l’autre — si ce que l’on souhaite c’est être compris.
« Autisme », c’est un mot extrêmement stigmatisant à la base. C’est un mot que tout le monde connaît et dont tout le monde pense connaître la signification. Et c’est une signification qui ne correspond pas du tout à ce que veulent exprimer beaucoup de personnes qui l’utilisent. Je comprends bien la démarche qui est de vouloir « déstigmatiser » un terme en se l’appropriant: on a un exemple avec « queer » par exemple, mais notons que le sens « stigmatisant » du mot était bien moins solidement ancré dans l’inconscient lexical qu’il ne l’est pour le mot « autiste », et qu’il y a une certaine naïveté linguistique et sociologique à penser qu’on peut reprendre ainsi le contrôle sur un mot.
Je pense, en fait, que le problème est moins dans le « je suis » que dans le « autiste ». Et que débattre sur le verbe (« être » versus « avoir ») c’est faire fausse route et vouer l’échange à l’échec, parce qu’en effet, dire « je suis xyz » n’en fait pas une question identitaire en soi — le repli identitaire peut très bien être réactif, suite aux réactions négatives à la formulation choisie pour parler de soi.
Dans ma réflexion, je cherchais d’autres mots « parallèles » qui pourraient également démontrer le phénomène que j’observe ici. Si on dit « je suis paraplégique » (un autre exemple aperçu dans les échanges), pourquoi ça ne me fait pas le même effet qu’entendre « je suis autiste »? Idem pour « je suis bipolaire », ou « je suis dyslexique »? Parce que les associations inconscientes (la connotation) sont différentes. Ce n’est pas le verbe qui fait ça. Est-ce qu’on peut donc trouver un terme qui démontre aussi cette problématique d’associations?
Le meilleur que j’ai trouvé — et qui me concerne — c’est « sourd ». Et, intéressant à noter, c’est aussi un terme autour de l’utilisation duquel émerge une problématique identitaire. Et il y a toute une série de débats terminologiques dans le « spectre » de la surdité (qu’on ne retrouve pas côté TDAH — je me demande d’ailleurs ce qu’il en est pour les handicaps de la vue?).
Déballons. Je dis que je suis malentendante. Je ne dis pas « je suis sourde ». Pourquoi? Si je dis “je suis sourde”, les gens comprennent quelque chose qui ne correspond pas à ma réalité. Pour beaucoup de monde, “sourd” ça veut dire “n’entend rien” ou au minimum “ne comprend rien”. En fait, strictement parlant, il y a différents degrés de surdité, mais le grand public a une vision beaucoup plus simpliste de tout ça. J’ai une surdité légère à moyenne congénitale (stable). J’ai fonctionné sans appareillage jusqu’à l’âge de 38 ans, fait des études, enseigné, etc. Pour la plupart des gens, je suis dans la catégorie “entend pas bien”. La nana un peu chiante à qui il faut répéter les choses, qui entend pas quand on l’appelle, qui comprend de travers, qui parle fort. Pas “sourde”, au sens où on le comprend. Donc je ne dis pas “je suis sourde” (risquant des réactions de type “hah mais t’es pas sourde, arrête de raconter n’importe quoi” – ça vous dit quelque chose, ça?) mais “je suis malentendante”. Preuve en est que si quelque chose “passe mal” pour moi quand j’entends “je suis autiste”, ce n’est pas le “je suis” qui est en cause mais ce qui vient après.
Le parallèle ne s’arrête pas là. “Sourd”, c’est stigmatisé et stigmatisant, comme terme. La surdité, contrairement à la cécité qui limite principalement le rapport à l’environnement, ça vient directement impacter le rapport à autrui – le lien social. La personne “sourde”, dans l’imaginaire populaire un peu historique, c’est “le sourd-muet”, c’est la personne qui ne parle pas, et aussi dont l’intellect est affecté (vu qu’on ne peut pas communiquer avec). On sait bien que c’est faux – tout comme on sait bien que ce à quoi on fait référence quand on parle d’autisme n’est pas à réduire aux histoires d’il y a des décennies, d’enfants non-verbaux avec déficit intellectuel enfermés dans des institutions et “coupés du monde”. Mais les mots continuent, malgré nous et malgré tout, à charrier ces petits wagons de connotations, d’implicite. On notera, concernant la surdité, l’utilisation du terme Sourd avec une majuscule pour l’identité culturelle.
Bon, ceci devait être un commentaire sur LinkedIn, ça s’est transformé en billet de blog… C’est une réflexion qui vaut ce qu’elle vaut. En résumé, voici où j’en suis:
- l’utilisation de la formule “je suis autiste” pose d’autres problèmes que celui de la revendication identitaire – il faut en tenir compte également;
- les débats autour de la revendication identitaire sont légitimes et importants mais s’ils se focalisent sur la formulation (“je suis xyz”), ils risquent de nous faire courir après un hareng rouge au lieu de rester dans le sujet.