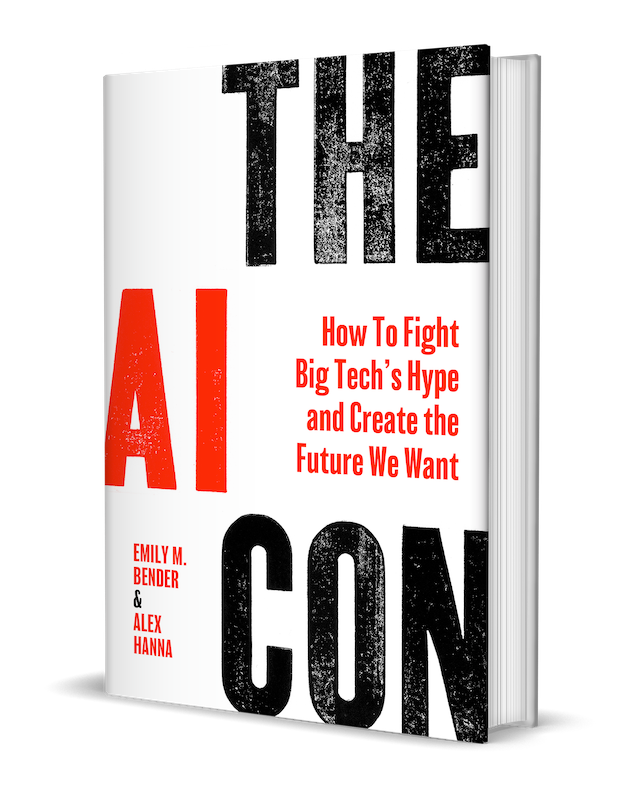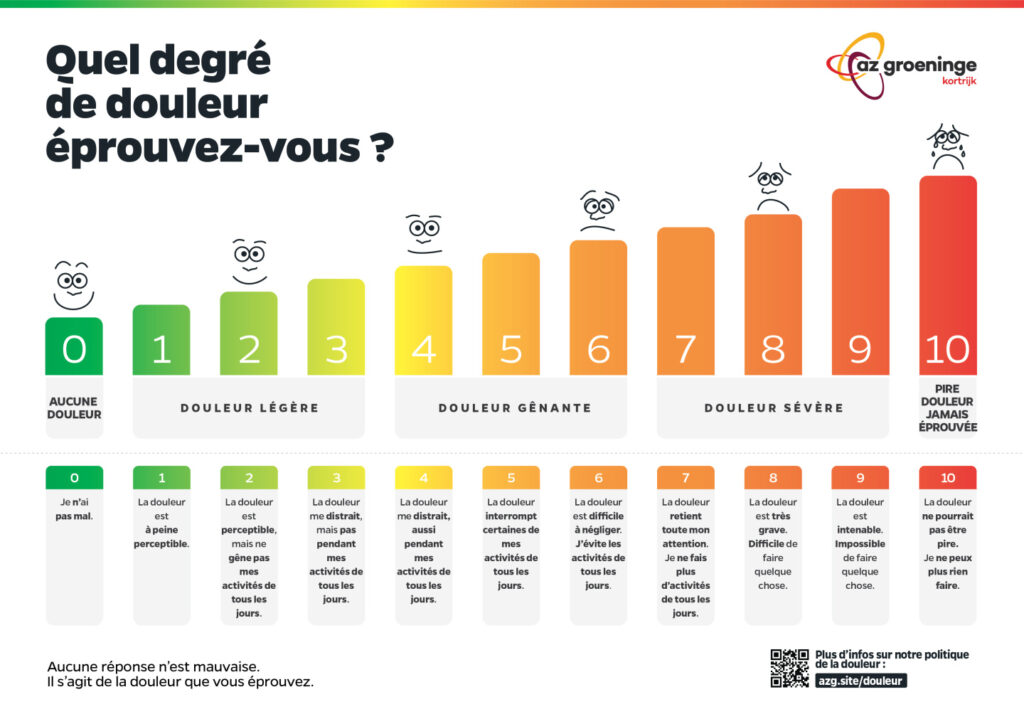Sludge : de la dégradation volontaire du service client
Dans The Atlantic, Chris Colin raconte le moment où il a eu un problème avec l’électronique de sa Ford. La direction se bloque, plus possible de ne rien faire. Son garagiste reboot le système sans chercher plus loin. Inquiet que le problème puisse se reproduire, Colin fait plusieurs garagistes, contacte Ford. On promet de le rappeler. Rien. A force de volonté, il finit par avoir un responsable qui lui explique qu’à moins que « le dysfonctionnement du véhicule puisse être reproduit et ainsi identifié, la garantie ne s’applique pas ». Colin multiplie les appels, au constructeur, à son assureur… Tout le monde lui dit de reprendre le volant. Lui persévère. Mais ses appels et mails sont renvoyés jusqu’à ne jamais aboutir. Il n’est pas le seul à qui ce genre de démêlés arrive. Une connaissance lui raconte le même phénomène avec une compagnie aérienne contre laquelle elle se débat pour tenter de se faire rembourser un voyage annulé lors du Covid. D’autres racontent des histoires kafkaïennes avec Verizon, Sonos, Airbnb, le Fisc américain… « Pris séparément, ces tracas étaient des anecdotes amusantes. Ensemble, elles suggèrent autre chose ».
Quelque soit le service, partout, le service client semble être passé aux abonnées absents. Le temps où les services clients remboursaient ou échangaient un produit sans demander le moindre justificatif semble lointain. En 2023, l’enquête nationale sur la colère des consommateurs américains avait tous ses chiffres au rouge. 74% des clients interrogés dans ce sondage ont déclaré avoir rencontré un problème avec un produit ou un service au cours de l’année écoulée, soit plus du double par rapport à 1976. Face à ces difficultés, les clients sont de plus en plus agressifs et en colère. L’incivilité des clients est certainement la réponse à des services de réclamation en mode dégradés quand ils ne sont pas aux abonnés absents.
Dégradation du service client : le numérique est-il responsable ?
Dans leur best-seller Nudge, paru en 2008, le juriste Cass Sunstein et l’économiste Richard Thaler ont mobilisé des recherches en sciences du comportement pour montrer comment de petits ajustements pouvaient nous aider à faire de meilleurs choix, définissant de nouvelles formes d’intervention pour accompagner des politiques pro-sociales (voir l’article que nous consacrions au sujet, il y a 15 ans). Dans leur livre, ils évoquaient également l’envers du nudge, le sludge : des modalités de conception qui empêchent et entravent les actions et les décisions. Le sludge englobe une gamme de frictions telles que des formulaires complexes, des frais cachés et des valeurs par défaut manipulatrices qui augmentent l’effort, le temps ou le coût requis pour faire un choix, profitant souvent au concepteur au détriment de l’intérêt de l’utilisateur. Cass Sunstein a d’ailleurs fini par écrire un livre sur le sujet en 2021 : Sludge. Il y évoque des exigences administratives tortueuses, des temps d’attente interminables, des complications procédurales excessives, voire des impossibilités à faire réclamation qui nous entravent, qui nous empêchent… Des modalités qui ne sont pas sans faire écho à l’emmerdification que le numérique produit, que dénonce Cory Doctorow. Ou encore à l’âge du cynisme qu’évoquaient Tim O’Reilly, Illan Strauss et Mariana Mazzucato en expliquant que les plateformes se focalisent désormais sur le service aux annonceurs plus que sur la qualité de l’expérience utilisateur… Cette boucle de prédation qu’est devenu le marketing numérique.
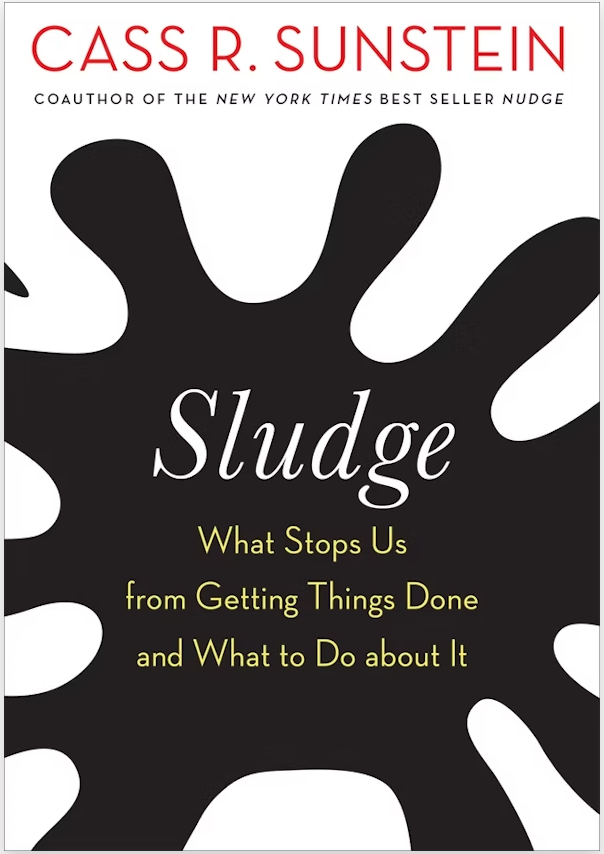
L’une des grandes questions que posent ces empêchements consiste d’ailleurs à savoir si le numérique les accélère, les facilite, les renforce.
Le sludge a suscité des travaux, rappelle Chris Colin. Certains ont montré qu’il conduit des gens à renoncer à des prestations essentielles. « Les gens finissent par payer ce contre quoi ils n’arrivent pas à se battre, faute d’espace pour contester ou faire entendre leur problème ». En l’absence de possibilité de discussion ou de contestation, vous n’avez pas d’autre choix que de vous conformer à ce qui vous est demandé. Dans l’application que vous utilisez pour rendre votre voiture de location par exemple, vous ne pouvez pas contester les frais que le scanneur d’inspection automatisé du véhicule vous impute automatiquement. Vous n’avez pas d’autre choix que de payer. Dans d’innombrables autres, vous n’avez aucune modalité de contact. C’est le fameux no-reply, cette communication sans relation que dénonçait Thierry Libaert pour la fondation Jean Jaurès – qui n’est d’ailleurs pas propre aux services publics. En 2023, Propublica avait montré comment l’assureur américain Cigna avait économisé des millions de dollars en rejetant des demandes de remboursement sans même les faire examiner par des médecins, en pariant sur le fait que peu de clients feraient appels. Même chose chez l’assureur santé américain NaviHealth qui excluait les clients dont les soins coûtaient trop cher, en tablant sur le fait que beaucoup ne feraient pas appels de la décision, intimidés par la demande – alors que l’entreprise savait que 90 % des refus de prise en charge sont annulés en appel. Les refus d’indemnisation, justifiés ou non, alimentent la colère que provoquent déjà les refus de communication. La branche financement de Toyota aux Etats-Unis a été condamnée pour avoir bloqué des remboursements et mis en place, délibérément, une ligne d’assistance téléphonique « sans issue » pour l’annulation de produits et services. Autant de pratiques difficiles à prouver pour les usagers, qui se retrouvent souvent très isolés quand leurs réclamations n’aboutissent pas. Mais qui disent que la pratique du refus voire du silence est devenue est devenue une technique pour générer du profit.
Réduire le coût des services clients
En fait, expliquaient déjà en 2019 les chercheurs Anthony Dukes et Yi Zhu dans la Harvard Business Review : si les services clients sont si mauvais, c’est parce qu’en l’étant, ils sont profitables ! C’est notamment le cas quand les entreprises détiennent une part de marché importante et que leurs clients n’ont pas de recours. Les entreprises les plus détestées sont souvent rentables (et, si l’on en croit un classement américain de 2023, beaucoup d’entre elles sont des entreprises du numérique, et plus seulement des câblo-opérateurs, des opérateurs télécom, des banques ou des compagnies aériennes). Or, expliquent les chercheurs, « certaines entreprises trouvent rentable de créer des difficultés aux clients qui se plaignent ». En multipliant les obstacles, les entreprises peuvent ainsi limiter les plaintes et les indemnisations. Les deux chercheurs ont montré que cela est beaucoup lié à la manière dont sont organisés les centres d’appels que les clients doivent contacter, notamment le fait que les agents qui prennent les appels aient des possibilités de réparation limitées (ils ne peuvent pas rembourser un produit par exemple). Les clients insistants sont renvoyés à d’autres démarches, souvent complexes. Pour Stéphanie Thum, une autre méthode consiste à dissimuler les possibilités de recours ou les noyer sous des démarches complexes et un jargon juridique. Dukes et Zhu constatent pourtant que limiter les coûts de réclamation explique bien souvent le fait que les entreprises aient recours à des centres d’appels externalisés. C’est la piste qu’explore d’ailleurs Chris Colin, qui rappelle que l’invention du distributeur automatique d’appels, au milieu du XXe siècle a permis d’industrialiser le service client. Puis, ces coûteux services ont été peu à peu externalisés et délocalisés pour en réduire les coûts. Or, le principe d’un centre d’appel n’est pas tant de servir les clients que de « les écraser », afin que les conseillers au téléphone passent le moins de temps possible avec chacun d’eux pour répondre au plus de clients possibles.
C’est ce que raconte le livre auto-édité d’Amas Tenumah, Waiting for Service: An Insider’s Account of Why Customer Service Is Broken + Tips to Avoid Bad Service (En attente de service : témoignage d’un initié sur les raisons pour lesquelles le service client est défaillant + conseils pour éviter un mauvais service, 2021). Amas Tenumah (blog, podcast), qui se présente comme « évangéliste du service client », explique qu’aucune entreprise ne dit qu’elle souhaite offrir un mauvais service client. Mais toutes ont des budgets dédiés pour traiter les réclamations et ces budgets ont plus tendance à se réduire qu’à augmenter, ce qui a des conséquences directes sur les remboursements, les remises et les traitements des plaintes des clients. Ces objectifs de réductions des remboursements sont directement transmis et traduits opérationnellement auprès des agents des centres d’appels sous forme d’objectifs et de propositions commerciales. Les call centers sont d’abord perçus comme des centres de coûts pour ceux qui les opèrent, et c’est encore plus vrai quand ils sont externalisés.
Le service client vise plus à nous apaiser qu’à nous satisfaire
Longtemps, la mesure de la satisfaction des clients était une mesure sacrée, à l’image du Net Promoter Score imaginé au début 2000 par un consultant américain qui va permettre de généraliser les systèmes de mesure de satisfaction (qui, malgré son manque de scientificité et ses innombrables lacunes, est devenu un indicateur clé de performance, totalement dévitalisé). « Les PDG ont longtemps considéré la fidélité des clients comme essentielle à la réussite d’une entreprise », rappelle Colin. Mais, si tout le monde continue de valoriser le service client, la croissance du chiffre d’affaires a partout détrôné la satisfaction. Les usagers eux-mêmes ont lâché l’affaire. « Nous sommes devenus collectivement plus réticents à punir les entreprises avec lesquelles nous faisons affaire », déclare Amas Tenumah : les clients les plus insatisfaits reviennent à peine moins souvent que les clients les plus satisfaits. Il suffit d’un coupon de réduction de 20% pour faire revenir les clients. Les clients sont devenus paresseux, à moins qu’ils n’aient plus vraiment le choix face au déploiement de monopoles effectifs. Les entreprises ont finalement compris qu’elles étaient libres de nous traiter comme elles le souhaitent, conclut Colin. « Nous sommes entrés dans une relation abusive ». Dans son livre, Tenumah rappelle que les services clients visent bien plus « à vous apaiser qu’à vous satisfaire »… puisqu’ils s’adressent aux clients qui ont déjà payé ! Il est souvent le premier département où une entreprise va chercher à réduire les coûts.
Dans nombre de secteurs, la fidélité est d’ailleurs assez mal récompensée : les opérateurs réservent leurs meilleurs prix et avantages aux nouveaux clients et ne proposent aux plus fidèles que de payer plus pour de nouvelles offres. Une opératrice de centre d’appel, rappelle que les mots y sont importants, et que les opérateurs sont formés pour éluder les réclamations, les minorer, proposer la remise la moins disante… Une autre que le fait de tomber chaque fois sur une nouvelle opératrice qui oblige à tout réexpliquer et un moyen pour pousser les gens à l’abandon.
La complexité administrative : un excellent outil pour invisibiliser des objectifs impopulaires
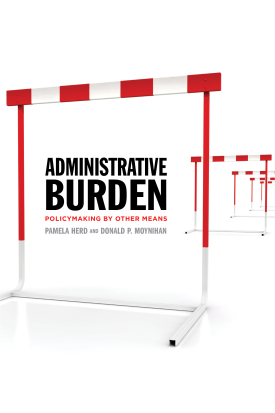
Dans son livre, Sunstein explique que le Sludge donne aux gens le sentiment qu’ils ne comptent pas, que leur vie ne compte pas. Pour la sociologue Pamela Herd et le politologue Donald Moynihan, coauteurs de Administrative Burden: Policymaking by Other Means (Russel Sage Foundation, 2019), le fardeau administratif comme la paperasserie complexe, les procédures confuses entravent activement l’accès aux services gouvernementaux. Plutôt que de simples inefficacités, affirment les auteurs, nombre de ces obstacles sont des outils politiques délibérés qui découragent la participation à des programmes comme Medicaid, empêchent les gens de voter et limitent l’accès à l’aide sociale. Et bien sûr, cette désorganisation volontaire touche de manière disproportionnée les gens les plus marginalisés. « L’un des effets les plus insidieux du sludge est qu’il érode une confiance toujours plus faible dans les institutions », explique la sociologue. « Une fois ce scepticisme installé, il n’est pas difficile pour quelqu’un comme Elon Musk de sabrer le gouvernement sous couvert d’efficacité »… alors que les coupes drastiques vont surtout compliquer la vie de ceux qui ont besoin d’aide. Mais surtout, comme l’expliquaient les deux auteurs dans une récente tribune pour le New York Times, les réformes d’accès, désormais, ne sont plus lisibles, volontairement. Les coupes que les Républicains envisagent pour l’attribution de Medicaid ne sont pas transparentes, elles ne portent plus sur des modifications d’éligibilité ou des réductions claires, que les électeurs comprennent facilement. Les coupes sont désormais opaques et reposent sur une complexité administrative renouvelée. Alors que les Démocrates avaient œuvré contre les lourdeurs administratives, les Républicains estiment qu’elles constituent un excellent outil politique pour atteindre des objectifs politiques impopulaires.
Augmenter le fardeau administratif devient une politique, comme de pousser les gens à renouveler leur demande 2 fois par an plutôt qu’une fois par an. L’enjeu consiste aussi à développer des barrières, comme des charges ou un ticket modérateur, même modique, qui permet d’éloigner ceux qui ont le plus besoin de soins et ne peuvent les payer. Les Républicains du Congrès souhaitent inciter les États à alourdir encore davantage les formalités administratives. Ils prévoient d’alourdir ainsi les sanctions pour les États qui commettent des erreurs d’inscription, ce qui va les encourager à exiger des justificatifs excessifs – alors que là bas aussi, l’essentiel de la fraude est le fait des assureurs privés et des prestataires de soins plutôt que des personnes éligibles aux soins. Les Républicains affirment que ces contraintes servent des objectifs politiques vertueux, comme la réduction de la fraude et de la dépendance à l’aide sociale. Mais en vérité, « la volonté de rendre l’assurance maladie publique moins accessible n’est pas motivée par des préoccupations concernant l’intérêt général. Au contraire, les plus vulnérables verront leur situation empirer, tout cela pour financer une baisse d’impôts qui profite principalement aux riches ».
Dans un article pour The Atlantic de 2021, Annie Lowrey évoquait le concept de Kludgeocracrie du politologue Steven Teles, pour parler de la façon dont étaient bricolés les programmes de prestations en faisant reposer sur les usagers les lourdeurs administratives. Le but, bien souvent, est que les prestations sociales ne soient pas faciles à comprendre et à recevoir. « Le gouvernement rationne les services publics par des frictions bureaucratiques déroutantes et injustes. Et lorsque les gens ne reçoivent pas l’aide qui leur est destinée, eh bien, c’est leur faute ». « C’est un filtre régressif qui sape toutes les politiques progressistes que nous avons ». Ces politiques produisent leurs propres économies. Si elles alourdissent le travail des administrations chargées de contrôler les prestations, elles diminuent mécaniquement le volume des prestations fournies.
Le mille-feuille de l’organisation des services publics n’explique pas à lui seul la raison de ces complexités. Dans un livre dédié au sujet (The Submerged State: How Invisible Government Policies Undermine American Democracy, University of Chicago Press, 2011), la politologue Suzanne Mettler soulignait d’ailleurs, que les programmes destinés aux plus riches et aux entreprises sont généralement plus faciles à obtenir, automatiques et garantis. « Il n’est pas nécessaire de se prosterner devant un conseiller social pour bénéficier des avantages d’un plan d’épargne-études. Il n’est pas nécessaire d’uriner dans un gobelet pour obtenir une déduction fiscale pour votre maison, votre bateau ou votre avion…». « Tant et si bien que de nombreuses personnes à revenus élevés, contrairement aux personnes pauvres, ne se rendent même pas compte qu’elles bénéficient de programmes gouvernementaux ». Les 200 milliards d’aides publiques aux entreprises en France, distribués sans grand contrôle, contrastent d’une manière saisissante avec la chasse à la fraude des plus pauvres, bardés de contrôles. Selon que vous êtes riches ou pauvres, les lourdeurs administratives ne sont pas distribuées équitablement. Mais toutes visent d’abord à rendre l’État dysfonctionnel.
L’article d’Annie Lowrey continue en soulignant bien sûr qu’une meilleure conception et que la simplification sont à portée de main et que certaines agences américaines s’y sont attelé et que cela a porté ses fruits. Mais, le problème n’est plus celui-là me semble-t-il. Voilà longtemps que les effets de la simplification sont démontrés, cela n’empêche pas, bien souvent, ni des reculs, ni une fausse simplification. Le contrôle reste encore largement la norme, même si partout on constate qu’il produit peu d’effets (comme le montraient les sociologues Claire Vivès, Luc Sigalo Santos, Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois et Hadrien Clouet, dans leur livre sur le contrôle du chômage, Chômeurs, vos papiers ! – voir notre recension). Il est toujours plus fort sur les plus démunis que sur les plus riches et la tendance ne s’inverse pas, malgré les démonstrations.
Et le déferlement de l’IA pour le marketing risque de continuer à dégrader les choses. Pour Tenumah, l’arrivée de services clients gérés par l’IA vont leur permettre peut-être de coûter moins cher aux entreprises, mais ils ne vont répondre à aucune attente.
La résistance au Sludge s’organise bien sûr. Des réglementations, comme la règle « cliquez pour annuler » que promeut la FTC américaine, vise à éliminer les obstacles à la résiliation des abonnements. L’OCDE a développé, elle, une internationale Sludge Academy pour développer des méthodes d’audits de ce type de problème, à l’image de la méthodologie développée par l’unité comportemementale du gouvernement australien. Mais la régulation des lacunes des services clients est encore difficile à mettre en œuvre.
Le cabinet Gartner a prédit que d’ici 2028, l’Europe inscrira dans sa législation le droit à parler à un être humain. Les entreprises s’y préparent d’ailleurs, puisqu’elles estiment qu’avec l’IA, ses employés seront capables de répondre à toutes les demandes clients. Mais cela ne signifie pas qu’elles vont améliorer leur relation commerciale. On l’a vu, il suffit que les solutions ne soient pas accessibles aux opérateurs des centres d’appels, que les recours ne soient pas dans la liste de ceux qu’ils peuvent proposer, pour que les problèmes ne se résolvent pas. Faudra-t-il aller plus loin ? Demander que tous les services aient des services de médiation ? Que les budgets de services clients soient proportionnels au chiffre d’affaires ?
Avec ses amis, Chris Colin organise désormais des soirées administratives, où les gens se réunissent pour faire leurs démarches ensemble afin de s’encourager à les faire. L’idée est de socialiser ces moments peu intéressants pour s’entraider à les accomplir et à ne pas lâcher l’affaire.
Après plusieurs mois de discussions, Ford a fini par proposer à Chris de racheter sa voiture pour une somme équitable.
Dégradation du service client ? La standardisation en question
Pour autant, l’article de The Atlantic ne répond pas pleinement à la question de savoir si le numérique aggrave le Sludge. Les pratiques léontines des entreprises ne sont pas nouvelles. Mais le numérique les attise-t-elle ?
« Après avoir progressé régulièrement pendant deux décennies, l’indice américain de satisfaction client (ACSI), baromètre du contentement, a commencé à décliner en 2018. Bien qu’il ait légèrement progressé par rapport à son point bas pendant la pandémie, il a perdu tous les gains réalisés depuis 2006 », rappelle The Economist. Si la concentration et le développement de monopoles explique en partie la dégradation, l’autre raison tient au développement de la technologie, notamment via le développement de chatbots, ces dernières années. Mais l’article finit par reprendre le discours consensuel pour expliquer que l’IA pourrait améliorer la relation, alors qu’elle risque surtout d’augmenter les services clients automatisés, allez comprendre. Même constat pour Claer Barrett, responsable de la rubrique consommateur au Financial Times. L’envahissement des chatbots a profondément dégradé le service client en empêchant les usagers d’accéder à ce qu’ils souhaitent : un humain capable de leur fournir les réponses qu’ils attendent. L’Institute of Customer Service (ICS), un organisme professionnel indépendant qui milite pour une amélioration des normes de la satisfaction client, constate néanmoins que celle-ci est au plus bas depuis 9 ans dans tous les secteurs de l’économie britannique. En fait, les chatbots ne sont pas le seul problème : même joindre un opérateur humain vous enferme également dans le même type de scripts que ceux qui alimentent les chatbots, puisque les uns comme les autres ne peuvent proposer que les solutions validées par l’entreprise. Le problème repose bien plus sur la normalisation et la standardisation de la relation qu’autre chose.
« Les statistiques des plaintes des clients sont très faciles à manipuler », explique Martyn James, expert en droits des consommateurs. Vous pourriez penser que vous êtes en train de vous plaindre au téléphone, dit-il, mais si vous n’indiquez pas clairement que vous souhaitez déposer une plainte officielle, celle-ci risque de ne pas être comptabilisée comme telle. Et les scripts que suivent les opérateurs et les chatbots ne proposent pas aux clients de déposer plainte… Pourquoi ? Légalement, les entreprises sont tenues de répondre aux plaintes officielles dans un délai déterminé. Mais si votre plainte n’est pas officiellement enregistrée comme telle, elles peuvent traîner les pieds. Si votre plainte n’est pas officiellement enregistrée, elle n’est qu’une réclamation qui se perd dans l’historique client, régulièrement vidé. Les consommateurs lui confient que, trop souvent, les centres d’appels n’ont aucune trace de leur réclamation initiale.
Quant à trouver la page de contact ou du service client, il faut la plupart du temps cinq à dix clics pour s’en approcher ! Et la plupart du temps, vous n’avez accès qu’à un chat ou une ligne téléphonique automatisée. Pour Martyn James, tous les secteurs ont réduit leur capacité à envoyer des mails autres que marketing et la plupart n’acceptent pas les réponses. Et ce alors que ces dernières années, de nombreuses chaînes de magasins se sont transformées en centres de traitement des commandes en ligne, sans investir dans un service client pour les clients distants.
« Notre temps ne leur coûte rien »
« Notre temps ne leur coûte rien », rappelle l’expert. Ce qui explique que nous soyons contraints d’épuiser le processus automatisé et de nous battre obstinément pour parler à un opérateur humain qui fera son maximum pour ne pas enregistrer l’interaction comme une plainte du fait des objectifs qu’il doit atteindre. Une fois les recours épuisés, reste la possibilité de saisir d’autres instances, mais cela demande de nouvelles démarches, de nouvelles compétences comme de savoir qu’un médiateur peut exister, voire porter plainte en justice… Autant de démarches qui ne sont pas si accessibles.
Les défenseurs des consommateurs souhaitent que les régulateurs puissent infliger des amendes beaucoup plus lourdes aux plus grands contrevenants des services clients déficients. Mais depuis quels critères ?
Investir dans un meilleur service client a clairement un coût. Mais traiter les plaintes de manière aussi inefficace en a tout autant. Tous secteurs confondus, le coût mensuel pour les entreprises britanniques du temps consacré par leurs employés à la gestion des problèmes clients s’élève à 8 milliards d’euros, selon l’ICS. Si les entreprises commençaient à mesurer cet impact de cette manière, cela renforcerait-il l’argument commercial en faveur d’un meilleur service ?, interroge Claer Barrett.
Au Royaume-Uni, c’est le traitement des réclamations financières qui offre le meilleur service client, explique-t-elle, parce que la réglementation y est beaucoup plus stricte. A croire que c’est ce qui manque partout ailleurs. Pourtant, même dans le secteur bancaire, le volume de plaintes reste élevé. Le Financial Ombudsman Service du Royaume-Uni prévoit de recevoir plus de 181 000 plaintes de consommateurs au cours du prochain exercice, soit environ 10 % de plus qu’en 2022-2023. Les principales plaintes à l’encontre des banques portent sur l’augmentation des taux d’intérêts sur les cartes de crédits et la débancarisation (voir notre article). Une autre part importante des plaintes concerne les dossiers de financement automobiles, et porte sur des litiges d’évaluation de dommages et des retards de paiements.
Pourtant, selon l’ICS, le retour sur investissement d’un bon service client reste fort. « D’après les données collectées entre 2017 et 2023, les entreprises dont le score de satisfaction client était supérieur d’au moins un point à la moyenne de leur secteur ont enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires de 7,4 % ». Mais, celles dont le score de satisfaction est inférieur d’un point à la moyenne, ont enregistré également une croissance de celui-ci du niveau de la moyenne du secteur. La différence n’est peut-être pas suffisamment sensible pour faire la différence. Dans un monde en ligne, où le client ne cesse de s’éloigner des personnels, la nécessité de créer des liens avec eux devrait être plus importante que jamais. Mais, l’inflation élevée de ces dernières années porte toute l’attention sur le prix… et ce même si les clients ne cessent de déclarer qu’ils sont prêts à payer plus cher pour un meilleur service.
La morosité du service client est assurément à l’image de la morosité économique ambiante.
Hubert Guillaud