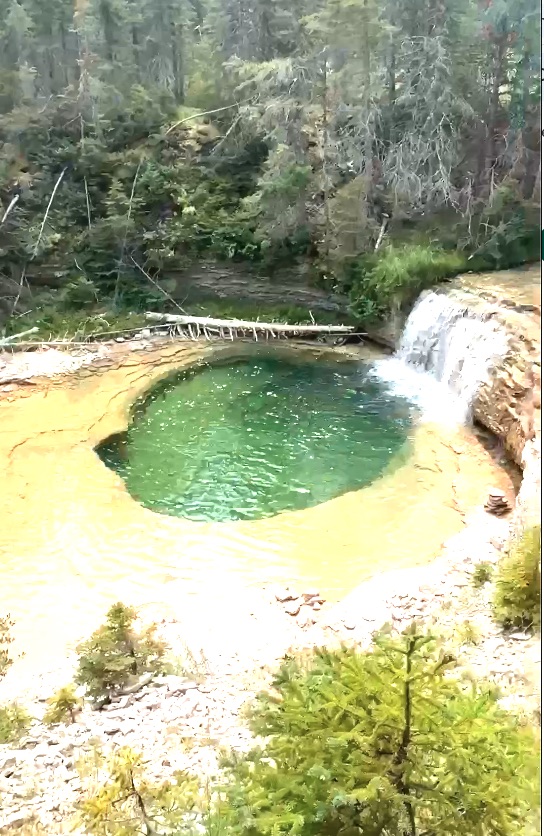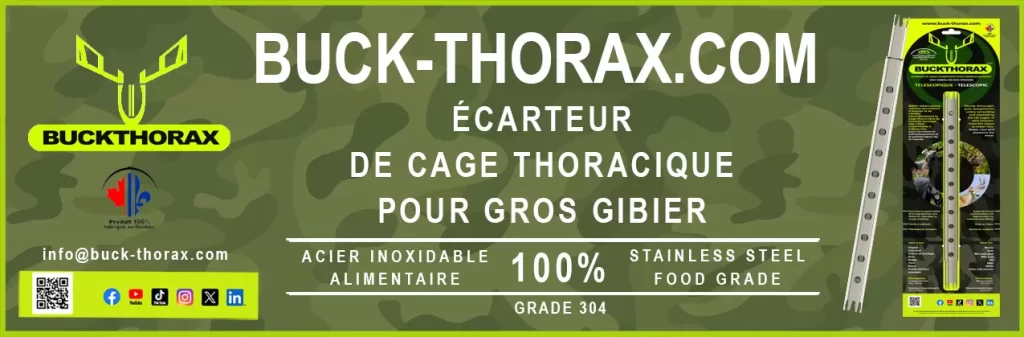Trois zecs de la zone 2 protégeront la femelle orignal

Les zecs Owen, Chapais et Bas-Saint-Laurent, de la zone 2, vont de l’avant pour assurer la protection de la femelle orignal lors de la prochaine saison de chasse 2025, même si le plan de gestion permet une chasse permissive des trois segments du troupeau, soit le mâle, la femelle et le veau.

Les zecs Owen et Chapais ont endossé, le 27 août dernier, le plan B de protection de l’orignal sans bois en 2025, initié et proposé par la ZEC-BSL, en réaction au refus de Québec d’assurer la sauvegarde de l’orignal sans bois en 2025, par une chasse restrictive, tout en permettant le prélèvement de la femelle avec un permis spécial.
Une décision qui laissait peu de marge de manœuvre à la grande ZEC-BSL, déterminée à prendre les grands moyens et d’aller jusqu’au bout pour protéger la ressource reproductrice.
Zecs solidaires à un même objectif
Le président de la ZEC-BSL, de la régionale des zecs et porte-parole des trois zecs, Guillaume Ouellet, réagit à l’accord, y voyant des marques d’unité et de solidarité des gestionnaires des territoires.
« On démontre encore une fois qu’on a à cœur nos territoires fauniques et la gestion de notre faune », dit-il, ajoutant avoir informé le ministère responsable de la Faune. « Qui a été très collaborateur ».
Cette gestion de l’orignal des trois zecs donne lieu au programme « Chasseur Responsable de la Faune » (CRF), dont l’objectif est de protéger volontairement la femelle orignal, même si la chasse permissive autorise cette année les trois segments du troupeau.

Les chasseurs d’un même groupe décideront d’épargner ou non la femelle, et d’opter pour la récolte du mâle. Ils seront identifiés à leur choix.
Pour inciter la récolte du mâle orignal, les chasseurs CRF et ceux de la relève participeront aux tirages de prix de grande valeur. Un autre tirage de prix s’adressera aux chasseurs non inscrits au CRF.
Face-à-face du président
Cet accord unanime des trois zecs lance une vaste campagne de sensibilisation et de promotion qui sera menée incessamment auprès de leurs chasseurs d’orignaux respectifs.
Le président Guillaume Ouellet s’adressera aux chasseurs via une vidéo en ligne sur la page Facebook de la ZEC-BSL.
Durant 17 minutes, il relate le fil des événements menant à ce choix volontaire de protéger la femelle orignal. Seul devant la caméra, debout, comme dans un face-à-face avec le chasseur, il décrit sa démarche de A à Z.

« Je parle en chasseur et je m’adresse à lui. On ne s’ennuiera pas. J’explique tout, tout, tout, tout. Quiconque ne pourra dire qu’il ne savait pas. Bien au fait de la démarche, 100 % des chasseurs devraient devenir membre CRF », estime Guillaume Ouellet. Un dépliant d’information sera aussi distribué aux chasseurs.
Ce grand virage dans ce type de gestion unique de l’orignal, en accord entre trois zecs d’une même zone, représente la volonté unanime des gestionnaires de se prendre en main.
Ils se en se donnent la liberté… accordée par Québec, de faire des choix sur la récolte d’une espèce comme l’orignal, afin d’assurer sa pérennité et l’avenir de leur territoire, on assiste ainsi à l’amorce d’une autonomie de gestion faunique plus grande pour les 63 zecs de la province.