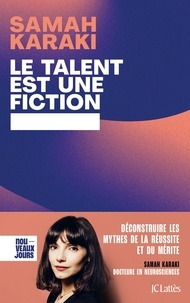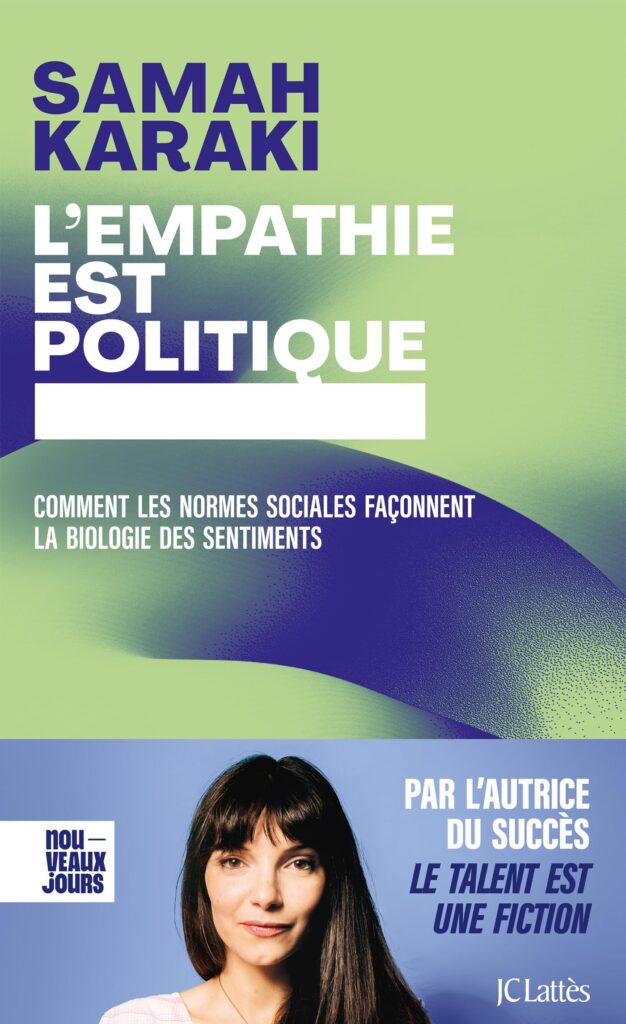Pascal Chabot : Coincés dans les digitoses
Pascal Chabot est philosophe et enseigne à l’Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles. Son plus récent ouvrage, Un sens à la vie : enquête philosophique sur l’essentiel (PUF, 2024) fait suite à une riche production de livres, où la question du numérique est toujours présente, lancinante, quand elle n’est pas au cœur de sa réflexion. L’occasion de revenir avec lui sur comment les enjeux numériques d’aujourd’hui questionnent la philosophie. Entretien.
Dans les algorithmes : Dans votre dernier livre, Un sens à la vie, vous vous interrogez sur le meaning washing, c’est à la dire à la fois sur la perte de sens de nos sociétés contemporaines et leur récupération, par exemple par le consumérisme qui nous invite à consommer pour donner du sens à l’existence. Pour vous, notre monde contemporain est saisi d’une “dissonance majeure”, où les sources de sens s’éloignent de nous du fait du développement d’environnements entièrement artificiels, du monde physique comme du monde numérique.
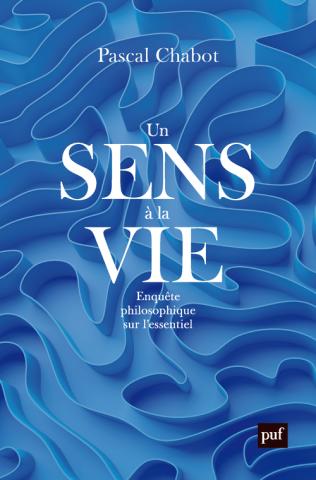
Vous interrogez cette perte de sens ou notre difficulté, fréquente, à retrouver du sens dans les contradictions de la modernité. Retrouver le sens nécessite de trouver comment circuler entre les sensations, les significations et les orientations, expliquez-vous, c’est-à-dire à trouver des formes de circulations entre ce que l’on ressent, ce qu’on en comprend et là où l’on souhaite aller. “Vivre, c’est faire circuler du sens”, le désirer, se le réapproprier. Mais le sens que tout à chacun cherche est aujourd’hui bouleversé par le numérique. Le sens “est transformé par les modalités de sa transmission” dites-vous. En quoi ces nouvelles modalités de transmission modifient-elles notre compréhension même du monde ?
Pascal Chabot : Une chose qui m’intéresse beaucoup en philosophie, c’est de comprendre comment des questions, anciennes, traditionnelles, sont à la fois toujours actuelles et bouleversées par ce que nous vivons. Par rapport à la question du sens, qui est un accord entre ce que l’on sent, ce que l’on comprend et ce que l’on devient, les choses ont peu bougé. Un ancien grec ou un humaniste de la Renaissance auraient pu faire des constats sur le sens de la vie proches des miens, pour peu qu’ils aient été en dehors des très grands récits de transcendance qui s’imposaient alors, où le sens est donné par Dieu ou le Salut, c’est à dire où le sens a un nom avec une majuscule. Cette façon de faire circuler du sens dans nos vies, on la partage avec nos lointains prédécesseurs dans l’histoire de la philosophie. Il y a une lignée humaine dans laquelle nous sommes chacun profondément inscrits.
Cela étant, après avoir dit la continuité, il faut penser la rupture. Et la rupture, selon moi, elle est dans le branchement de nos consciences à ce que j’appelle le surconscient numérique. La conscience, telle qu’elle est ordinairement définie à partir du XXe siècle et bien sûr de Freud, est toujours couplée à son inconscient. Cette découverte, d’un enrichissement inédit, même si l’on ne sait pas toujours très bien ce qu’est l’inconscient, est restée d’une grande originalité, en apportant ce binôme conscience-inconscience qui permet d’enrichir notre compréhension de la pensée, en accord avec une nature humaine profonde, allant des grands mythes freudiens à la nature, dans lesquels notre inconscient peut s’exprimer, que ce soit via la sexualité ou la contemplation. Ce binôme a permis de créer des sens nouveaux. Cependant, je crois qu’on est de plus en plus débranchés de notre inconscient. C’est pourquoi une partie de la psychiatrie et de la psychanalyse ont un mal fou à comprendre ce qu’il se passe avec les nouvelles pathologies. En revanche, on est beaucoup plus branché, on fait couple, avec ce surconscient auquel on a accès dès qu’on fait le geste de consulter un écran. Ce mot surconscient, créé par analogie avec l’inconscient, est un mot assez large qui désigne pour moi un réseau, un dôme d’information, de communication, de protocoles d’échanges, d’images, qui a une certaine conscience. Une conscience relative comme l’inconscient a lui-même une conscience relative. Ce n’est pas une conscience en terme de « JE », mais de « NOUS ». C’est un savoir exploitable par la conscience et l’inconscient et qui est de plus en plus déterminant sur notre conscience comme sur notre inconscient.
Dans les algorithmes : Mais on pourrait dire que ce surconscient existait avant le numérique, non ? Des grands récits à la presse, toutes nos formes médiatiques et culturelles y participaient. Pourquoi le numérique modifierait-il particulièrement ce rapport ?
Pascal Chabot : Oui, toute œuvre culturelle, de la presse à la littérature, crée des bulles de signification, un cadre de signification, avec lequel nous sommes en dialogue. La graphosphère, comme on l’a parfois appelé, existe. Mais la grande différence, c’est que le monde numérique propose un monde où les significations ont une vie propre. Ce que Tolstoï a écrit par exemple, a été écrit une fois pour toute. On se réfère à Guerre et Paix à partir des significations qui ont été données depuis un écrit stabilisé. Si Guerre et Paix continue à vivre, c’est par l’acte d’enrichissement du livre dans notre imagination, dans nos souvenirs, dans notre mémoire. Dans le monde du surconscient numérique, il n’y a pas d’inertie. Les informations sont modifiées, mises à jour, répétées, dynamiques, avec une personnalisation des contenus continue. Cette personnalisation là est assez spécifique, centrée sur les personnes, calibrée pour chacun d’entre nous.
Cette personnalisation est une caractéristique importante. Il y en a une autre, celle du temps. Quand on se réfère à un livre écrit à la fin du XIXe siècle, on fait venir dans le temps présent un objet du passé. La sphère numérique est caractérisée par un temps nouveau, comme je l’évoquais dans Avoir le temps, où j’essayais de dire, qu’il y a eu deux grands temps. Le temps comme destin, c’est le temps de la nature, et le temps du progrès, celui de la construction d’un monde commun. Dans le numérique on vit un hypertemps. Un temps de synchronisation permanente. Un temps où la nouveauté est tout le temps présente. Un temps décompté, à rebours. Le temps du surconscient est aussi cet hypertemps. On est de moins en moins dans l’espace et de plus en plus dans des bulles temporelles qui s’ouvrent notamment quand on est dans la consommation de l’écran, où l’on se branche à un hypertemps commun.
« Dans le monde du surconscient numérique, il n’y a pas d’inertie. Les informations sont modifiées, mises à jour, répétées, dynamiques, avec une personnalisation des contenus continue. Cette personnalisation là est assez spécifique, centrée sur les personnes, calibrée pour chacun d’entre nous. »
Dans les algorithmes : Cette consommation d’écran, ce pas de côté dans nos réalités, nécessite de « faire le geste » dites-vous, c’est-à-dire d’ouvrir son smartphone. Geste que nous faisons des centaines de fois par jour. « Nous passons nos vies à caresser une vitre », ironise l’écrivain Alain Damasio. C’est consulter, nous brancher en permanence, dans un geste qui est désormais si présent dans notre quotidien, qu’il ne semble nullement le perturber, alors qu’il l’entrecoupe sans arrêt. Or, ce geste nous coupe de nos environnements. Il réduit nos sensations, limite nos orientations… Comme si ce geste était le symptôme de notre envahissement par ce surconscient…
Pascal Chabot : C’est effectivement sa matérialisation. C’est par ce geste que le surconscient colonise nos consciences. On dit beaucoup qu’on vit une mutation anthropologique majeure, mais elle est orchestrée par des ultraforces, c’est-à-dire des moyens qui ne sont pas une fin mais une force en soi, comme le sont la finance ou le numérique. « Faire le geste » nous fait changer de réalité, nous fait muter, nous fait passer dans un autre monde. Un monde très libidinal, un monde qui sait nos intentions, qui satisfait nos désirs. Un monde qui nous rend captif mais qui nous permet surtout de quitter une réalité qui nous apparaît de moins en moins satisfaisante. Le rapport au présent, à la matérialité, nous apparaît désormais plus pauvre que le voyage dans le surconscient de l’humanité. La plupart d’entre nous sommes devenus incapables de rester 5 minutes sans « faire le geste ». Toute addiction est aphrodisiaque : elle nous promet un désir qu’on ne peut plus avoir ailleurs. Comme si notre conscience et notre inconscient ne nous suffisaient plus.
Dans les algorithmes : Vous reconnaissez pourtant que ce surconscient a des vertus : « il fait exploser nos compréhensions », dites-vous. Vous expliquez que le rendement informationnel du temps que l’on passe sur son smartphone – différent de son impact intellectuel ou affectif – est bien supérieur à la lecture d’un livre ou même d’un dialogue avec un collègue. Que notre connexion au réseau permet de zoomer et dézoomer en continue, comme disait le sociologue Dominique Cardon, nous permet d’aller du micro au macro. Nous sommes plongés dans un flux continu de signifiants. “Les sensations s’atrophient, les significations s’hypertrophient. Quant aux orientations, en se multipliant et se complexifiant, elles ouvrent sur des mondes labyrinthiques” qui se reconfigurent selon nos circulations. Nous sommes plongés dans un surconscient tentaculaire qui vient inhiber notre inconscient et notre conscience. Ce surconscient perturbe certes la circulation du sens. Mais nos écrans ne cessent de produire du sens en permanence…
Pascal Chabot : Oui, mais ce surconscient apporte de l’information, plus que du sens. Je parle bien de rendement informationnel. Quand les livres permettent eux de déployer l’imagination, la créativité, la sensibilité, l’émotivité… de les ancrer dans nos corps, de dialoguer avec l’inconscient. En revanche, ce que nous offre le surconscient en terme quantitatif, en précision, en justesse est indéniable. Comme beaucoup, j’ai muté des mondes de la bibliothèque au monde du surconscient. Il était souvent difficile de retrouver une information dans le monde des livres. Alors que le surconscient, lui, est un monde sous la main. Nous avons un accès de plus en plus direct à l’information. Et celle-ci se rapproche toujours plus de notre conscience, notamment avec ChatGPT. La recherche Google nous ouvrait une forme d’arborescence dans laquelle nous devions encore choisir où aller. Avec les chatbots, l’information arrive à nous de manière plus directe encore.
Mais l’information n’est ni le savoir ni la sagesse et sûrement pas le sens.
Dans les algorithmes : Vous dites d’ailleurs que nous sommes entrés dans des sociétés de la question après avoir été des sociétés de la réponse. Nous sommes en train de passer de la réponse qu’apporte un article de Wikipédia, à une société de l’invite, à l’image de l’interface des chatbots qui nous envahissent, et qui nous invitent justement à poser des questions – sans nécessairement en lire les réponses d’ailleurs. Est-ce vraiment une société de la question, de l’interrogation, quand, en fait, les réponses deviennent sans importance ?
Pascal Chabot : Quand j’évoque les sociétés de la question et de la réponse, j’évoque les sociétés modernes du XVIIe et du XVIIIe siècle, des sociétés où certaines choses ne s’interrogent pas, parce qu’il y a des réponses partout. La question du sens ne hante pas les grands penseurs de cette époque car pour eux, le sens est donné. Les sociétés de la question naissent de la mort de Dieu, de la perte de la transcendance et du fait qu’on n’écrit plus le sens en majuscule. Ce sont des sociétés de l’inquiétude et du questionnement. La question du sens de la vie est une question assez contemporaine finalement. C’est Nietzsche qui est un des premiers à la poser sous cette forme là.
Dans la société de la question dans laquelle nous entrons, on interroge les choses, le sens… Mais les réponses qui nous sont faites restent désincanées. Or, pour que le sens soit présent dans une existence, il faut qu’il y ait un enracinement, une incarnation… Il faut que le corps soit là pour que la signification soit comprise. Il faut une parole et pas seulement une information. De même, l’orientation, le chemin et son caractère initiatique comme déroutant, produisent du sens.
Mais, si nous le vivons ainsi c’est parce que nous avons vécu dans un monde de sensation, de signification et d’orientation relativement classique. Les plus jeunes n’ont pas nécessairement ces réflexes. Certains sont déjà couplés aux outils d’IA générative qui leurs servent de coach particuliers en continue… C’est un autre rapport au savoir qui arrive pour une génération qui n’a pas le rapport au savoir que nous avons construit.
Dans les algorithmes : Vous expliquez que cette extension du surconscient produit des pathologies que vous qualifiez de digitoses, pour parler d’un conflit entre la conscience et le surconscient. Mais pourquoi parlez-vous de digitose plutôt que de nouvelles névroses ou de nouvelles psychoses ?
Pascal Chabot : Quand j’ai travaillé sur la question du burn-out, j’ai pu constater que le domaine de la santé mentale devait évoluer. Les concepts classiques, de névrose ou de psychose, n’étaient plus opérants pour décrire ces nouvelles afflictions. Nous avions des notions orphelines d’une théorie plus englobante. Le burn-out ou l’éco-anxiété ne sont ni des névroses ni des psychoses. Pour moi, la santé mentale avait besoin d’un aggiornamento, d’une mise à jour. J’ai cherché des analogies entre inconscient et surconscient, le ça, le là, le refoulement et le défoulement… J’ai d’abord trouvé le terme de numérose avant de lui préféré le terme de digitose en référence au digital plus qu’au numérique. C’est un terme qui par son suffixe en tout cas ajoute un penchant pathologique au digital. Peu à peu, les digitoses se sont structurées en plusieurs familles : les digitoses de scission, d’avenir, de rivalité… qui m’ont permis de créer une typologie des problèmes liés à un rapport effréné ou sans conscience au numérique qui génère de nouveaux types de pathologies.
Dans les algorithmes : Le terme de digitose, plus que le lien avec le surconscient, n’accuse-t-il pas plus le messager que le message ? Sur l’éco-anxiété, l’information que l’on obtient via le numérique peut nous amener à cette nouvelle forme d’inquiétude sourde vis à vis du futur, mais on peut être éco-anxieux sans être connecté. Or, dans votre typologie des digitoses, c’est toujours le rapport au numérique qui semble mis au banc des accusés…
Pascal Chabot : Je ne voudrais pas donner l’impression que je confond le thermomètre et la maladie effectivement. Mais, quand même : le média est le message. Ce genre de pathologies là, qui concernent notre rapport au réel, arrivent dans un monde où le réel est connu et transformé par le numérique. Pour prendre l’exemple de l’éco-anxiété, on pourrait tout à fait faire remarquer qu’elle a existé avant internet. Le livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux, par exemple, date des années 60.
Mais, ce qui est propre au monde numérique est qu’il a permis de populariser une connaissance de l’avenir que le monde d’autrefois ne connaissait absolument pas. L’avenir a toujours été le lieu de l’opacité, comblé par de grands récits mythiques ou apocalyptiques. Aujourd’hui, l’apport informationnel majeur du numérique, permet d’avoir pour chaque réalité un ensemble de statistiques prospectives extrêmement fiables. On peut trouver comment vont évoluer les populations d’insectes, la fonte des glaciers, les températures globales comme locales… Ce n’est pas uniquement le média numérique qui est mobilisé ici, mais la science, la technoscience, les calculateurs… c’est-à-dire la forme contemporaine du savoir. Les rapports du Giec en sont une parfaite illustration. Ils sont des éventails de scénarios chiffrés, sourcés, documentés… assortis de probabilités et validés collectivement. Ils font partie du surconscient, du dôme de savoir dans lequel nous évoluons et qui étend sa chape d’inquiétude et de soucis sur nos consciences. L’éco-anxiété est une digitose parce que c’est le branchement à ce surconscient là qui est important. Ce n’est pas uniquement la digitalisation de l’information qui est en cause, mais l’existence d’un contexte informationnel dont le numérique est le vecteur.
« Le numérique a permis de populariser une connaissance de l’avenir que le monde d’autrefois ne connaissait absolument pas »
Dans les algorithmes : Ce n’est pas le fait que ce soit numérique, c’est ce que ce branchement transforme en nous…
Pascal Chabot : Oui, c’est la même chose dans le monde du travail, par rapport à la question du burn-out… Nombre de burn-out sont liés à des facteurs extra-numériques qui vont des patrons chiants, aux collègues toxiques… et qui ont toujours existé, hélas. Mais dans la structure contemporaine du travail, dans son exigence, dans ce que les algorithmes font de notre rapport au système, au travail, à la société… ces nouveaux branchements, ce reporting constant, cette normalisation du travail… renforcent encore les souffrances que nous endurons.
« L’éco-anxiété est une digitose parce que c’est le branchement à ce surconscient là qui est important. Ce n’est pas uniquement la digitalisation de l’information qui est en cause, mais l’existence d’un contexte informationnel dont le numérique est le vecteur. »
Dans les algorithmes : Outre la digitose de scission (le burn-out), et la digitose d’avenir (l’éco-anxiété) dont vous nous avez parlé, vous évoquez aussi la digitose de rivalité, celle de notre confrontation à l’IA et de notre devenir machine. Expliquez-nous !
Pascal Chabot : Il faut partir de l’écriture pour la comprendre. Ce que l’on délègue à un chatbot, c’est de l’écriture. Bien sûr, elles peuvent générer bien d’autres choses, mais ce sont d’abord des machines qui ont appris à aligner des termes en suivant les grammaires pour produire des réponses sensées, c’est-à-dire qui font sens pour quelqu’un qui les lit. Ce qui est tout à fait perturbant, c’est que de cette sorte de graphogenèse, de genèse du langage graphique, naît quelque chose comme une psychogenèse. C’est simplement le bon alignement de termes qui répond à telle ou telle question qui nous donne l’impression d’une intentionnalité. Depuis que l’humanité est l’humanité, un terme écrit nous dit qu’il a été pensé par un autre. Notre rapport au signe attribue toujours une paternité. L’humanité a été créée par les Ecritures. Les sociétés religieuses, celles des grands monothéismes, sont des sociétés du livre. Être en train de déléguer l’écriture à des machines qui le feront de plus en plus correctement, est quelque chose d’absolument subjuguant. Le problème, c’est que l’humain est paresseux et que nous risquons de prendre cette voie facile. Nos consciences sont pourtant nées de l’écriture. Et voilà que désormais, elles se font écrire par des machines qui appartiennent à des ultraforces qui ont, elles, des visées politiques et économiques. Politique, car écrire la réponse à la question « la démocratie est-elle un bon régime ? » dépendra de qui relèvent de ces ultraforces. Économique, comme je m’en amusait dans L’homme qui voulait acheter le langage… car l’accès à ChatGPT est déjà payant et on peut imaginer que les accès à de meilleures versions demain, pourraient être plus chères encore. La capitalisme linguistique va continuer à se développer. L’écriture, qui a été un outil d’émancipation démocratique sans commune mesure (car apprendre à écrire a toujours été le marqueur d’entrée dans la société), risque de se transformer en simple outil de consommation. Outre la rivalité existentielle de l’IA qui vient dévaluer notre intelligence, les impacts politiques et économiques ne font que commencer. Pour moi, il y dans ce nouveau rapport quelque chose de l’ordre de la dépossession, d’une dépossession très très profonde de notre humanité.
Dans les algorithmes : Ecrire, c’est penser. Être déposséder de l’écriture, c’est être dépossédé de la pensée.
Pascal Chabot : Oui et cela reste assez vertigineux. Notamment pour ceux qui ont appris à manier l’écriture et la pensée. Ecrire, c’est s’emparer du langage pour lui injecter un rythme, une stylistique et une heuristique, c’est-à-dire un outil de découverte, de recherche, qui nous permet de stabiliser nos relations à nous-mêmes, à autrui, au savoir… Quand on termine un mail, on réfléchit à la formule qu’on veut adopter en fonction de la relation à l’autre que nous avons… jusqu’à ce que les machines prennent cela en charge. On a l’impression pour le moment d’être au stade de la rivalité entre peinture et photographie vers 1885. Souvenons-nous que la photographie a balayé le monde ancien.
Mais c’est un monde dont il faut reconnaître aussi les limites et l’obsolescence. Le problème des nouvelles formes qui viennent est que le sens qu’elles proposent est bien trop extérieur aux individus. On enlève l’individu au sens. On est dans des significations importées, dans des orientations qui ne sont pas vécues existentiellement.
Dans les algorithmes : Pour répondre aux pathologies des digitoses, vous nous invitez à une thérapie de civilisation. De quoi avons-nous besoin pour pouvoir répondre aux digitoses ?
Pascal Chabot : La conscience, le fait d’accompagner en conscience ce que nous faisons change la donne. Réfléchir sur le temps, prendre conscience de notre rapport temporel, change notre rapport au temps. Réfléchir à la question du sens permet de prendre une hauteur et de créer une série de filtres permettant de distinguer des actions insensées qui relèvent à la fois des grandes transcendance avec une majuscule que des conduites passives face au sens. La thérapie de la civilisation, n’est rien d’autre que la philosophie. C’est un plaidoyer pro domo ! Mais la philosophie permet de redoubler ce que nous vivons d’une sorte de conscience de ce que nous vivons : la réflexivité. Et cette façon de réfléchir permet d’évaluer et garder vive la question de l’insensé, de l’absurde et donc du sens.
Dans les algorithmes : Dans ce surconscient qui nous aplatit, comment vous situez-vous face aux injonctions à débrancher, à ne plus écouter la télévision, la radio, à débrancher les écrans ? Cela relève d’un levier, du coaching comportemental ou est-ce du meaning washing ?
Pascal Chabot : Je n’y crois pas trop. C’est comme manger des légumes ou faire pipi sous la douche. Les mouvements auxquels nous sommes confrontés sont bien plus profonds. Bien sûr, chacun s’adapte comme il peut. Je ne cherche pas à être jugeant. Mais cela nous rappelle d’ailleurs que la civilisation du livre et de l’écrit a fait beaucoup de dégâts. La conscience nous aide toujours à penser mieux. Rien n’est neutre. Confrontés aux ultraforces, on est dans un monde qui développe des anti-rapports, à la fois des dissonnances, des dénis ou des esquives pour tenter d’échapper à notre impuissance.
Dans les algorithmes : Vous êtes assez alarmiste sur les enjeux civilisationnels de l’intelligence artificielle que vous appelez très joliment des « communicants artificiels ». Et de l’autre, vous nous expliquez que ces outils vont continuer la démocratisation culturelle à l’œuvre. Vous rappelez d’ailleurs que le protestantisme est né de la généralisation de la lecture et vous posez la question : « que naîtra-t-il de la généralisation de l’écriture ? »
Mais est-ce vraiment une généralisation de l’écriture à laquelle nous assistons ? On parle de l’écriture de et par des machines. Et il n’est pas sûr que ce qu’elles produisent nous pénètrent, nous traversent, nous émancipent. Finalement, ce qu’elles produisent ne sont que des réponses qui ne nous investissent pas nécessairement. Elles font à notre place. Nous leur déléguons non seulement l’écriture, mais également la lecture… au risque d’abandonner les deux. Est-ce que ces outils produisent vraiment une nouvelle démocratisation culturelle ? Sommes-nous face à un nouvel outil interculturel ou assistons-nous simplement à une colonisation et une expansion du capitalisme linguistique ?
Pascal Chabot : L’écriture a toujours été une sorte de ticket d’entrée dans la société et selon les types d’écritures dont on était capable, on pouvait pénétrer dans tel ou tel milieu. L’écriture est très clairement un marqueur de discrimination sociale. C’est le cas de l’orthographe, très clairement, qui est la marque de niveaux d’éducation. Mais au-delà de l’orthographe, le fait de pouvoir rédiger un courrier, un CV… est quelque chose de très marqué socialement. Dans une formation à l’argumentation dans l’équivalent belge de France Travail, j’ai été marqué par le fait que pour les demandeurs d’emploi, l’accès à l’IA leur changeait la vie, leur permettant d’avoir des CV, des lettres de motivation adaptées. Pour eux, c’était un boulet de ne pas avoir de CV corrects. Même chose pour les étudiants. Pour nombre d’entre eux, écrire est un calvaire et ils savent très bien que c’est ce qu’ils ne savent pas toujours faire correctement. Dans ces nouveaux types de couplage que l’IA permet, branchés sur un surconscient qui les aide, ils ont accès à une assurance nouvelle.
Bien sûr, dans cette imitation, personne n’est dupe. Mais nous sommes conditionnés par une société qui attribue à l’auteur d’un texte les qualités de celui-ci, alors que ses productions ne sont pas que personnelles, elles sont d’abord le produit des classes sociales de leurs auteurs, de la société dont nous sommes issus. Dans ce nouveau couplage à l’IA, il me semble qu’il y a quelque chose de l’ordre d’une démocratisation.
Dans les algorithmes : Le risque avec l’IA, n’est-il pas aussi, derrière la dépossession de l’écriture, notre dépossession du sens lui-même ? Le sens nous est désormais imposé par d’autres, par les résultats des machines. Ce qui m’interroge beaucoup avec l’IA, c’est cette forme de délégation des significations, leur aplatissement, leur moyennisation. Quand on demande à ces outils de nous représenter un mexicain, ils nous livrent l’image d’une personne avec un sombrero ! Or, faire société, c’est questionner tout le temps les significations pour les changer, les modifier, les faire évoluer. Et là, nous sommes confrontés à des outils qui les figent, qui excluent ce qui permet de les remettre en cause, ce qui sort de la norme, de la moyenne…
Pascal Chabot : Oui, nous sommes confrontés à un « Bon gros bon sens » qui n’est pas sans rappeler Le dictionnaire des idées de reçues de Flaubert…
Dans les algorithmes : …mais le dictionnaire des idées reçues était ironique, lui !
Pascal Chabot : Il est ironique parce qu’il a vu l’humour dans le « Bon gros bon sens ». Dans la société, les platitudes circulent. C’est la tâche de la culture et de la créativité de les dépasser. Car le « Bon gros bon sens » est aussi très politique : il est aussi un sens commun, avec des assurances qui sont rabachées, des slogans répétés…. Les outils d’IA sont de nouveaux instruments de bon sens, notamment parce qu’ils doivent plaire au plus grand monde. On est très loin de ce qui est subtil, de ce qui est fin, polysémique, ambiguë, plein de doute, raffiné, étrange, surréaliste… C’est-à-dire tout ce qui fait la vie de la culture. On est plongé dans un pragmatisme anglo-saxon, qui a un rapport au langage très peu polysémique d’ailleurs. Le problème, c’est que ce « Bon gros bon sens » est beaucoup plus invasif. Il a une force d’autorité. Le produit de ChatGPT ne nous est-il pas présenté d’ailleurs comme un summum de la science ?
« Les outils d’IA sont de nouveaux instruments de bon sens, notamment parce qu’ils doivent plaire au plus grand monde. On est très loin de ce qui est subtil, de ce qui est fin, polysémique, ambiguë, plein de doute, raffiné, étrange, surréaliste… C’est-à-dire tout ce qui fait la vie de la culture. »
Dans les algorithmes : Et en même temps, ce calcul laisse bien souvent les gens sans prise, sans moyens d’action individuels comme collectifs.
Le point commun entre les différentes digitoses que vous listez me semble-t-il est que nous n’avons pas de réponses individuelles à leur apporter. Alors que les névroses et psychoses nécessitent notre implication pour être réparées. Face aux digitoses, nous n’avons pas de clefs, nous n’avons pas de prises, nous sommes sans moyen d’action individuels comme collectifs. Ne sommes nous pas confrontés à une surconscience qui nous démunie ?
Pascal Chabot : Il est certain que le couplage des consciences au surconscient, en tant qu’elle est un processus de civilisation, apparaît comme un nouveau destin. Il s’impose, piloté par des ultraforces sur lesquelles nous n’avons pas de prise. En ce sens, il s’agit d’un nouveau destin, avec tout ce que ce terme charrie d’imposition et d’inexorabilité.
En tant que les digitoses expriment le versant problématique de ce nouveau couplage, elles aussi ont quelque chose de fatal. Branchée à une réalité numérique qui la dépasse et la détermine, la conscience peine souvent à exprimer sa liberté, qui est pourtant son essence. La rivalité avec les IA, l’eco-anxiété, la scission avec le monde sensible : autant de digitoses qui ont un aspect civilisationnel, presque indépendant du libre-arbitre individuel. Les seules réponses, en l’occurrence, ne peuvent être que politiques. Mais là aussi, elles ne sont pas faciles à imaginer.
Or on ne peut pourtant en rester là. Si ce seul aspect nécessaire existait, toute cette théorie ne serait qu’une nouvelle formulation de l’aliénation. Mais les digitoses ont une composante psychologique, de même que les névroses et psychoses. Cette composante recèle aussi des leviers de résistance. La prise de conscience, la lucidité, la reappropriation, l’hygiène mentale, une certaine désintoxication, le choix de brancher sa conscience sur des réalités extra-numériques, et tant d’autres stratégies encore, voire tant d’autres modes de vies, peuvent très clairement tempérer l’emprise de ces digitoses sur l’humain. C’est dire que l’individu, face à ce nouveau destin civilisationnel, garde des marges de résistance qui, lorsqu’elles deviennent collectives, peuvent être puissantes.
Les digitoses sont donc un défi et un repoussoir : une occasion de chercher et d’affirmer des libertés nouvelles dans un monde où s’inventent sous nos yeux de nouveaux déterminismes.
Dans les algorithmes : Derrière le surconscient, le risque n’est-il pas que s’impose une forme de sur-autorité, de sur-vision… sur lesquelles, il sera difficile de créer des formes d’échappement, de subtilité, d’ambiguité. On a l’impression d’être confronté à une force politique qui ne dit pas son nom mais qui se donne un nouveau moyen de pouvoir…
Pascal Chabot : C’est clair que la question est celle du pouvoir, politique et économique. Les types de résistances sont extrêmement difficiles à inventer. C’est le propre du pouvoir de rendre la résistance à sa force difficile. On est confronté à un tel mélange de pragmatisme, de facilitation de la vie, de création d’une bulle de confort, d’une enveloppe où les réponses sont faciles et qui nous donnent accès à de nouveaux mondes, comme le montrait la question de la démocratisation qu’on évoquait à l’instant… que la servitude devient très peu apparente. Et la perte de subtilité et d’ambiguïté est peu vue, car les gains économiques supplantent ces pertes. Qui se rend compte de l’appauvrissement ? Il faut avoir un pied dans les formes culturelles précédentes pour cela. Quand les choses seront plus franches, ce que je redoute, c’est que nos démocraties ne produisent pas de récits numériques pour faire entendre une autre forme de puissance.
Dans les algorithmes : En 2016 vous avez publié, ChatBot le robot, une très courte fable écrite bien avant l’avènement de l’IA générative, qui met en scène un jury de philosophes devant décider si une intelligence artificielle est capable de philosopher. Ce petit drame philosophique où l’IA fomente des réponses à des questions philosophiques, se révèle très actuel 9 ans plus tard. Qualifieriez vous ChatGPT et ses clones de philosophes ?
Pascal Chabot : Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce chatbot là se le décernerait à lui, comme il est difficile à un artiste de se dire artiste. Mon Chatbot était un récalcitrant, ce n’est pas le cas des outils d’IA d’aujourd’hui. Il leur manque un rapport au savoir, le lien entre la sensation et la signification. La philosophie ne peut pas être juste de la signification. Et c’est pour cela que l’existentialisme reste la matrice de toute philosophie, et qu’il n’y a pas de philosophie qui serait non-existentielle, c’est-à-dire pure création de langage. La graphogenèse engendre une psychogenèse. Mais la psychogenèse, cette imitation de la conscience, n’engendre ni philosophie ni pensée humaine. Il n’y a pas de conscience artificielle. La conscience est liée à la naissance, la mort, la vie.
Dans les algorithmes : La question de l’incalculabité est le sujet de la conférence USI 2025 à laquelle vous allez participer. Pour un un philosophe, qu’est-ce qui est incalculable ?
Pascal Chabot : L’incalculable, c’est le subtil ! L’étymologie de subtil, c’est subtela, littéralement, ce qui est en-dessous d’une toile. En dessous d’une toile sur laquelle on tisse, il y a évidémment la trame, les fils de trame. Le subtil, c’est les fils de trame, c’est-à-dire nos liens majeurs, les liens à nous-mêmes, aux autres, au sens, à la culture, nos liens amoureux, amicaux… Et tout cela est profondément de l’ordre de l’incalculable. Et tout cela est même profané quand on les calcule. Ces liens sont ce qui résiste intrinsèquement à la calculabilité, qui est pourtant l’un des grands ressort de l’esprit humain et pas seulement des machines. Le problème, c’est qu’on est tellement dans une idéologie de la calculabilité qu’on ne perçoit même plus qu’on peut faire des progrès dans le domaine du subtil. Désormais, le progrès semble lié à la seule calculabilité. Le progrès est un progrès du calculable et de l’utile. Or, je pense qu’il existe aussi un progrès dans le domaine du subtil. Dans l’art d’être ami par exemple, dans l’art d’être lié à soi-même ou aux autres, il y a moyen de faire des progrès. Il y a là toute une zone de développement, de progrès (nous ne devons pas laisser le terme uniquement à la civilisation techno-économique), de progrès subtil. Un progrès subtil, incalculable, mais extrêmement précieux.
Propos recueillis par Hubert Guillaud.
Pascal Chabot sera l’un des intervenants de la conférence USI 2025 qui aura lieu lundi 2 juin à Paris et dont le thème est « la part incalculable du numérique » et pour laquelle Danslesalgorithmes.net est partenaire.